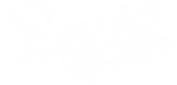Dans le monde des réseaux sociaux, l’expression semble libre, à portée de téléphone portable : pas besoin d’avoir un capital de départ, d’investir dans des machines sophistiquées. Cette dématérialisation est présentée comme la base d’une démocratie absente des médias traditionnels. Mais derrière les apparences et l’amour de la liberté proclamé par les richissimes propriétaires des réseaux sociaux, il y a des intérêts sonnants et trébuchants, et une volonté d’influencer l’opinion, volonté partagée par tous les capitalistes qui investissent dans les médias.
Des infrastructures colossales
À la base des réseaux sociaux, il y a d’abord, on l’oublie souvent, des infrastructures très lourdes. Le partage d’informations et de données du monde entier, sur lequel sont basés Internet et les réseaux sociaux, repose en particulier sur la pose de câbles sous-marins. Aujourd’hui, près de 450 câbles sillonnent la planète, cumulant 1,2 million de kilomètres, près de trente fois sa circonférence. Les navires qui posent ces équipements au fond des océans appartiennent à de grands groupes, seuls capables de cet investissement. En septembre 2021, un consortium formé d’Orange, Google et Facebook a financé l’extension du plus grand câble du monde : 45 000 kilomètres entre Europe, Afrique et Asie. Tout récemment, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé un projet pharaonique à plusieurs milliards : un câble de 50 000 kilomètres. Ces équipements, qui permettent de relier le monde entier et par lesquels transitent 99 % des communications mondiales, appartiennent, comme n’importe quelle marchandise, à ceux qui paient, c’est-à-dire aux multinationales qui les installent. Et lorsqu’il ne s’agit pas de câbles sous-marins, ce sont des satellites, comme le réseau Starlink, lancé en 2018 par Elon Musk et en cours de déploiement. Le réseau a également besoin de centres de données, ces immenses bâtiments contenant des serveurs, sur lesquels sont stockées les données du monde entier. Il y en a environ 7 000 dans le monde, dont 1 200 aux États-Unis, et environ 300 en France. Ces centres de stockage nécessitent énormément d’électricité : leur consommation devrait tripler d’ici à 2030, selon le cabinet McKinsey. En Europe, cela pourrait représenter jusqu’à 5 % de la consommation totale de tout le continent. Aux États-Unis, les projets de centres de données lancés par les géants du numérique représentent 92 gigawatts, près de la moitié de la consommation domestique du pays.
Il faut aussi compter le travail humain nécessaire pour mettre en œuvre ces moyens de production : des ingénieurs concevant toujours de nouveaux algorithmes et imaginant de nouvelles fonctionnalités, jusqu’aux petites mains chargées d’entraîner les nouveaux modèles d’intelligence artificielle pour des salaires de misère dans les pays pauvres.
Tout cela ne peut surgir qu’avec des moyens importants. La propriété privée des moyens de production en donne la jouissance exclusive à son propriétaire. Cette loi fondamentale du capitalisme est valable pour la production industrielle comme pour la production intellectuelle. En conséquence de quoi, ceux qui investissent dans les infrastructures nécessaires aux réseaux sociaux et à Internet d’une manière générale en ont l’usage exclusif, et s’en servent pour défendre leurs intérêts.
Une affaire très rentable
En réalité, la liberté d’expression promise par les capitalistes du numérique est d’abord et avant tout une affaire très rentable. N’importe qui peut créer gratuitement un compte sur un réseau social, mais ce faisant, il accepte que la plateforme exploite ses données personnelles. Autrement dit, elle va utiliser elle-même, ou revendre à d’autres entreprises, les données qu’elle collecte lorsque l’utilisateur est actif. Les plateformes savent très précisément combien de temps il passe sur le réseau social, ce qu’il a regardé, avec quelles personnes il a interagi, le genre de vidéos qu’il regarde le plus souvent… Ces données sont achetées par des entreprises, qui peuvent ainsi adapter leur marketing, envoyer de la publicité ciblée et influencer les achats. Toute une stratégie commerciale est déployée sur les réseaux sociaux, afin que les utilisateurs restent le plus longtemps possible connectés et qu’ils visionnent donc un maximum de publicités. Ainsi, sur certaines plateformes, l’interface est conçue pour que les vidéos affluent sans arrêt, en boucle : on peut passer des heures à les faire défiler. Les algorithmes, ces programmes informatiques définis par les plateformes, sélectionnent les contenus les plus forts émotionnellement pour rendre l’utilisateur « accro ». En 2022, les recettes de Meta, entre autres, s’élevaient à 116 milliards de dollars, dont 113 venaient de la publicité. 97 % des revenus de la plateforme de Zuckerberg viennent de la vente d’espaces publicitaires aux entreprises, qui peuvent ainsi obtenir l’attention, et ensuite le porte-monnaie, de l’utilisateur. Le 31 mars 2025, TikTok a même lancé une nouvelle fonctionnalité : l’achat en ligne, directement depuis l’application.
Les influenceurs jouent également un rôle important dans la stratégie commerciale des marques. Ces hommes ou ces femmes très actifs sur les réseaux sociaux sont parfois suivis par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Les grandes marques leur proposent alors de faire la promotion de leurs produits. En 2023, selon le magazine Challenges, elles auraient dépensé plus de 32 milliards de dollars pour rémunérer des influenceurs, devenus de véritables VRP du numérique. En 2022, une influenceuse française suivie par dix millions de personnes a ainsi participé au lancement du sac Saint-Honoré, de Dior. Il est bien sûr difficile d’évaluer l’impact commercial de cette pratique – combien d’utilisateurs achètent ensuite un produit de la marque ? – mais il est certain que si les entreprises dépensent autant, c’est que les profits doivent être au rendez-vous.
Il faut dire que le marché est immense, estimé à cinq milliards d’utilisateurs : 400 millions pour X, trois milliards pour Facebook, 1,7 milliard pour TikTok. Autant de consommateurs en puissance, qui sont la cible des capitalistes à travers les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, influenceurs d’opinion ?
Les réseaux sociaux n’ont pas pour but premier de permettre de s’exprimer librement. Ils sont d’abord un moyen de connaître et d’orienter les marchés, de vendre le plus efficacement possible, en ciblant toujours mieux les goûts personnels des utilisateurs. Mais les réseaux sociaux ont aussi un intérêt politique. Sous couvert de liberté d’expression, les plateformes et les capitalistes du numérique entendent influencer l’opinion publique. Ils sont libres de choisir qui peut s’exprimer ou pas, et sous quelles conditions, sur leurs plateformes. Si, après avoir mis la main sur Twitter en 2022 et l’avoir transformé en X, Elon Musk a rouvert le compte de Trump, il a en revanche voulu interdire l’utilisation de certains mots qu’il considère ressortir du « wokisme », comme « cisgenre », utilisé par la communauté LGBT, et considéré par le milliardaire comme une insulte. De même, un compte individuel peut être suspendu à tout moment, de manière arbitraire, et la contestation de cette procédure est très compliquée. Une enquête de la BBC[1] montre par exemple comment Meta a rendu invisibles les différents médias palestiniens après l’attaque du 7 octobre 2023, et laissé ainsi la place libre à la propagande de l’État israélien. Il a suffi, d’après les témoignages d’anciens employés, de modifier un algorithme interne pour supprimer certains comptes et contenus.
De ce point de vue, les réseaux sociaux ne sont pas très différents des médias traditionnels, télévision, radio, presse écrite, qui appartiennent à une poignée de capitalistes, directement ou à travers leurs parts dans des sociétés intermédiaires. On trouve parmi eux les grands noms du capitalisme français : les Bettencourt, Arnault, Dassault, Bolloré, Pinault, Bouygues, Lagardère, Saadé ; des banquiers comme la famille Rothschild ; des capitalistes plus récents, qui ont fait leur fortune avec l’essor du numérique, comme Xavier Niel. On trouve dans leurs portefeuilles les grands titres de la presse nationale, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, Le Parisien, Paris-Match, de nombreux titres régionaux comme La Provence, achetée par Saadé en 2022, ainsi que des radios comme NRJ, RTL, Europe 1, RMC, des chaînes de télévision comme W9, M6, TF1, LCI, BFM TV… Bien sûr, ces grands patrons n’interviennent pas directement dans leurs médias, ou du moins très rarement, même si un milliardaire ultra-réactionnaire comme Bolloré, défend ouvertement ses idées antiouvrières. En vertu du droit de propriété, ils peuvent modeler leurs médias à leur guise, en particulier en sélectionnant des équipes de journalistes dévoués. En mars 2024, Rodolphe Saadé, richissime patron du géant mondial du transport maritime CMA CGM et heureux propriétaire de plusieurs journaux, a jugé bon de limoger le rédacteur en chef de La Provence. Cela pour sa une qui lui avait déplu, car elle critiquait – de manière très modérée – l’opération « place nette » du gouvernement à Marseille, qui ne réglait rien du problème du trafic de drogue dans les cités. Mais de tels éclats sont rares. Les journalistes les plus en vue fréquentent leurs patrons, le milieu des affaires et le milieu politique, dont ils défendent les intérêts et les opinions, sans avoir besoin d’être rappelés à l’ordre.
Les réseaux sociaux paraissent quant à eux moins soumis à une ligne éditoriale, au contrôle des journalistes. Mais en réalité, même s’il ne semble pas y avoir d’intervention extérieure, les réseaux sociaux sont modelés par les algorithmes, entièrement maîtrisés par les plateformes. Ces programmes mettent en avant certains contenus plutôt que d’autres, opèrent des sélections suivant des critères définis par les plateformes. Certaines vont mettre en avant les centres d’intérêt, d’autres les interactions avec les autres utilisateurs, etc. Par exemple, si on affiche son intérêt pour la politique, les algorithmes proposeront très certainement des vidéos et des contenus venant d’Elon Musk ou de l’extrême droite d’une manière générale, quand bien même on a des idées politiques complètement opposées. Cet affichage, qui semble libre à première vue, est en réalité complètement biaisé par la façon de fonctionner des plateformes.
Ces manipulations des contenus, ainsi que leur immense popularité, font des réseaux sociaux une arme diplomatique, déployée entre autres dans la propagande antichinoise des gouvernements occidentaux. Biden a ainsi banni TikTok des États-Unis à la fin de son mandat, sous prétexte que sa société-mère est chinoise, et qu’il y aurait un fort risque d’ingérence étrangère. Il faut dire qu’en la matière, les États-Unis et leurs services secrets ont une très longue expérience. Trump a suspendu la décision, mais seulement à condition que la plateforme cède ses activités dans le pays à une entreprise américaine, une opportunité pour Elon Musk, qui s’est aussitôt dit intéressé. En Europe aussi, les réseaux sociaux sont utilisés, à la façon d’autres médias traditionnels, comme des outils de propagande. Toute la classe politique y a recours et les grands partis dépensent des moyens considérables pour inonder les réseaux lors des campagnes électorales. En dernier ressort, les différents appareils d’État ont toute latitude pour couper un réseau social, une chaîne de télévision ou un journal, ou pour en censurer les prétendus effets. Ainsi, en Roumanie, l’élection présidentielle du 24 novembre 2024 a été invalidée sous prétexte que le candidat prorusse arrivé en tête aurait bénéficié d’une campagne sur TikTok – en réalité, parce que le candidat déplaisait à l’Union européenne. En France, après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre en juin 2023, Macron avait également évoqué la possibilité de suspendre les réseaux sociaux lors d’événements de ce type. Le gouvernement a d’ailleurs fini par le faire lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie : il a suspendu TikTok, prétendant que les émeutiers promouvaient le terrorisme sur le réseau social.
Voilà ce qui se cache en dernier ressort derrière la « liberté d’expression » promise par les réseaux sociaux.
Nouvel outil, vieille préoccupation
Mais au fond, les réseaux sociaux ne sont qu’un moyen de communication moderne dont la bourgeoisie peut se servir pour asseoir sa domination. Les idées de la classe dominante imprègnent toute la société : l’organisation du travail comme la culture ou la philosophie. Les exploités ne peuvent accepter l’ordre des choses que tant qu’ils sont persuadés que cet ordre social injuste est le fait de la nature humaine, voire de Dieu. En bref, qu’on ne peut pas le changer, qu’il y a toujours eu des riches et des pauvres, que tout cela est dans l’ordre des choses. Pendant des siècles, la religion a joué ce rôle d’« opium du peuple », pour reprendre une expression célèbre de Marx. La mainmise du clergé sur la société a servi à influencer, à façonner l’opinion des classes exploitées, à qui elle prêchait, et prêche toujours, la soumission et l’attente. Lorsque l’école devint une institution, elle propagea également les idées de la bourgeoisie, défendant la République bourgeoise, ses conquêtes coloniales, le respect de l’État et de l’autorité. En 1846, dans L’Idéologie allemande, Marx analysait les modes de transmission des idées dans les sociétés de classe : « Les idées de la classe dominante sont, à cette époque, les idées dominantes ; en d’autres termes, la classe détentrice de la puissance matérielle dominante de la société représente en même temps la puissance spirituelle qui prédomine dans cette société. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production spirituelle. »
Le capitalisme, en développant les moyens de production, a produit d’importantes innovations en matière de communication : journaux, radio, cinéma, télévision, Internet… Chaque développement technologique a entraîné dans un premier temps une liberté plus grande. Certaines innovations sont nées d’idéaux humanistes. Dans les débuts d’Internet, il s’agissait d’échanger des informations notamment dans le domaine universitaire, car les différentes entreprises informatiques concevaient des ordinateurs incompatibles les uns avec les autres. L’aide de l’État est alors déterminante pour construire les infrastructures nécessaires, car les capitalistes ne veulent pas faire d’investissements lourds sans savoir si la technologie en question sera efficace et son utilisation rentable. Une fois la technologie déployée, les capitaux affluent et s’en emparent. Internet a été déployé d’abord sous l’aile militaire, avant son application civile puis son utilisation commerciale à partir des années 1990. On retrouve le même phénomène pour la radio, apparue dans les années 1920, ou la télévision, inventée à la même période, mais qui s’est développée essentiellement à partir des années 1950. Comme à chaque développement de nouveaux médias, ceux-ci apparaissent dans un premier temps comme un moyen d’information et d’expression plus libres, car les capitaux n’ont pas encore accaparé ce nouveau secteur. Dans les années 1970, en France, un mouvement pour les radios libres contesta le monopole de la diffusion radiophonique par l’État en installant des émetteurs illégaux. Ces radios critiquaient souvent, sinon l’organisation sociale, du moins l’ordre établi et ses valeurs. Mais elles se heurtaient au problème de leur financement. C’est alors que le débat sur la publicité surgit : pour échapper à la censure du pouvoir et continuer à émettre, les radios libres devaient-elles accepter de diffuser de la publicité ? Cela revenait naturellement à se mettre sous la coupe des capitaux privés. En France, le gouvernement mit fin au monopole de l’État en 1982 et légalisa du même coup les radios libres. Elles devinrent de simples radios privées qui, si elles ne voulaient pas perdre l’argent de leurs annonceurs, ne pouvaient émettre que des critiques très mesurées contre le système.
Le même problème se posa lorsque la télévision devint un objet du quotidien. Dans les années 1980, elle gagna pratiquement tous les foyers. Désormais, tous ceux qui pouvaient émettre furent à même de toucher des millions de téléspectateurs, avec un moyen de communication simple, direct, et la force des images en plus. Les recettes publicitaires explosèrent, et les appétits capitalistes avec. En 1984, André Rousselet, directeur de cabinet de Mitterrand, avant de diriger l’agence de communication Havas, lança Canal +, première chaîne de télévision payante française. En 1986, Jérôme Seydoux, grand patron français, et le milliardaire italien Silvio Berlusconi, lancèrent La Cinq, une nouvelle chaîne privée. Lors de la première cohabitation, entre Mitterrand président et Chirac Premier ministre, la droite entérina le double secteur audiovisuel : une partie publique et l’autre privée. Le geste fut joint à la parole, et TF1 fut confiée à Bouygues en 1987. Hersant, grand capitaliste français, et ancien collaborationniste notoire durant la Deuxième Guerre mondiale, mit la main sur La Cinq et M6, avec, entre autres, des capitaux de la Lyonnaise des eaux.
Le capital transforme tout en marchandise, y compris la liberté d’expression. La crise du capitalisme a pour effet que les capitalistes investissent de moins en moins dans la sphère productive. L’apparition des réseaux sociaux, et plus récemment de l’intelligence artificielle, est alors apparue comme une nouvelle manne pour les capitaux qui cherchaient des débouchés.
Les « réseaux » militants dont la classe ouvrière a besoin
Face à la puissance des moyens d’information du capitalisme, et en particulier des géants du numérique, comment des militants révolutionnaires peuvent-ils trouver le moyen de faire passer leurs idées ? Comme d’autres avancées technologiques, les réseaux sociaux ne sont ni la source d’une liberté absolue, ni l’arme du diable qui détruirait les rapports humains. Ils reflètent les contradictions du capitalisme et sont à la fois outils formidables de communication, et propagateurs de rumeurs, de fausses nouvelles et d’idées anti ouvrières. Il est vrai que les capitalistes, même les plus riches et les plus puissants, ne contrôlent pas toujours entièrement leur propre système. Les réseaux sociaux ne font pas exception, et parfois, la créature échappe à son maître. En 2011, ils ont joué un grand rôle dans la propagation des Printemps arabes, de même que lors du Hirak en Algérie en 2019, et lors du déclenchement du mouvement des gilets jaunes en France en 2018. L’accessibilité des réseaux sociaux peut en faire un outil très efficace lorsque les révoltés s’en emparent. En décembre 2024, le simple hashtag #JeNeSuisPasContent, qui traduisait un mécontentement vague et général de la population, s’est répandu en Algérie au point de rendre le pouvoir fébrile. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, preuve des craintes du gouvernement de voir la contestation exploser sur les réseaux sociaux. Lorsque les masses se mettent réellement en mouvement, elles trouvent toujours les moyens de s’exprimer, d’organiser des actions, de diffuser des informations, et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important dans cette propagation. Le pouvoir le sait si bien que nombre de régimes autoritaires verrouillent les moyens de communication, à commencer par les réseaux sociaux, et les fameux libertariens, dont Elon Musk se revendique, feraient de même si la contestation venait à leur échapper.
On ne voit ni pourquoi ni comment les militants communistes révolutionnaires devraient se passer des réseaux sociaux, qui sont devenus, pour des millions de personnes, la principale source d’information, bien avant les médias traditionnels. Mais si leurs idées ne « prennent » pas, ne deviennent pas virales, c’est que les réseaux sociaux ne sont que l’écho, très déformé par les biais évoqués, de l’opinion. Ils n’ont pas le pouvoir de transformer la situation générale, de faire reculer à eux seuls les idées réactionnaires produites par le capitalisme pourrissant. Ils traduisent au fond le rapport de force général, à un moment donné, entre la bourgeoisie et la classe ouvrière.
Pour ceux qui veulent préparer le renversement de cet ordre social, les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer une organisation, un véritable parti avec des liens humains. Ils ne peuvent que contribuer à diffuser plus largement des idées ou des informations, souvent de façon superficielle. Les révolutionnaires doivent se donner des moyens de propagande indépendants, et de ce point de vue, la presse écrite joue un rôle important. Historiquement, les journaux ont joué un rôle essentiel dans la structuration même du mouvement ouvrier et de ses organisations : depuis L’Écho de la Fabrique des canuts lyonnais (1831-1834) jusqu’à L’Iskra des révolutionnaires russes (1900-1917), en passant par le Northern Star des chartistes britanniques (1837-1852) ou par le Sozialdemokrat allemand (1879-1890), d’innombrables journaux ont permis aux travailleurs non seulement de s’informer, mais de forger une critique commune du capitalisme, et de s’organiser.
Faire vivre un journal nécessite de se battre pour trouver des financements auprès des lecteurs ouvriers, de trouver les imprimeries prêtes à mettre sous presse un journal révolutionnaire, d’avoir un réseau de distribution militant et des acheteurs qui, par leur geste, apportent un soutien… La confection d’un journal ouvrier, aussi bien dans sa conception que dans sa fabrication et dans sa diffusion, nécessite des liens humains et une organisation que ne peuvent offrir les réseaux sociaux.
Avoir une presse ouvrière indépendante fut un des combats majeurs du mouvement ouvrier. Même lorsqu’ils furent interdits en Allemagne en 1878, les socialistes allemands parvinrent à publier leur presse à l’étranger, et à la faire entrer clandestinement dans le pays, à travers leurs innombrables relais, ce qu’on appela « la poste rouge ». Avant la Première Guerre mondiale, le Parti social-démocrate allemand comptait des dizaines de quotidiens et revues et des centaines de milliers d’abonnés. En Russie, le Parti bolchevique avait bien compris l’importance de la question. Il sut déployer une énergie considérable, depuis l’étranger ou en faisant fonctionner des imprimeries clandestines, pour faire paraître ses journaux, qui atteignaient jusqu’au front les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Lors de la guerre civile qui suivit leur arrivée au pouvoir, le train de Trotsky, qui sillonnait le front, était équipé d’une petite imprimerie, afin d’éditer des tracts, et les nouveaux moyens technologiques de l’époque, notamment la radio, furent utilisés pour diffuser les idées de la révolution.
Utiliser les moyens techniques développés par le capitalisme est une nécessité. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont que des outils au service de la construction d’un parti ouvrier. Ce réseau militant, fondé sur des liens humains, sur une expérience et des intérêts de classe communs, devra sans aucun doute, au cours de son développement, créer des journaux, radios, réseaux sociaux, tous les moyens de diffuser ses idées pour préparer une société débarrassée du profit et de l’exploitation.
11 mai 2025
[1] Ahmed Nour, Joe Tidy et Yara Farag, « How Facebook restricted news in Palestinian territories », 18 décembre 2024. https://www.bbc.com/news/articles/c786wlxz4jgo