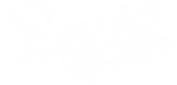« C’est comme un blitzkrieg (guerre éclair). Ils se rendent sans se battre. C’est extraordinaire et c’est essentiel. Quand on gagne, il faut continuer à frapper, il ne faut pas les laisser se relever, il ne faut pas qu’ils reprennent leur souffle, il faut les empêcher de se regrouper ou de s’organiser ! » Voilà comment Steve Bannon décrit les premiers mois de Trump dans un entretien au Washington Post. Si Bannon n’a plus de poste à la Maison Blanche, c’est bien lui qui a plus ou moins défini le populisme d’extrême droite avec lequel Trump flirte, et il a joué un rôle déterminant, dès 2012, dans l’accession de Trump à la présidence.
À côté du « blitzkrieg », Trump et son administration utilisent toute une phraséologie à connotation militaire, telle que « choc et effroi » ou « sabrer et brûler », et c’est tout à fait approprié, car ils mènent une guerre contre la classe ouvrière, en particulier contre les travailleurs employés par les organes fédéraux. Et ils sont en train de préparer la guerre vers laquelle l’impérialisme, à commencer par celui des États-Unis, emmène le monde.
Mettre en œuvre le programme de l’extrême droite
Elon Musk a été chargé de lancer l’attaque contre les travailleurs employés par l’État fédéral. Ni ce qu’il a fait ni le poste même qu’il occupe au Département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE dans son acronyme anglais) n’ont de fondement légal ou constitutionnel. Son titre lui a été conféré par Trump, qui entend simplement faire ce qu’il veut et lui a permis de se déchaîner et de s’en prendre aux agences gouvernementales. Musk est le bras armé de Trump. Plus tard, il pourra se transformer en fusible si nécessaire.
Avec une rapidité qui a médusé le monde politique, Musk a présenté aux employés fédéraux une « proposition qu’ils ne pouvaient pas refuser » : démissionner ou se faire virer, et ils avaient un délai de trois jours pour répondre. Dans les premières semaines, il a ainsi envoyé des courriels menaçants à 200 000 employés fédéraux. Des dizaines de milliers d’entre eux furent empêchés de rejoindre leur lieu de travail. L’ensemble du personnel fédéral était sur la sellette, chacun pouvant redouter d’être la victime suivante. C’était un moyen de forcer les travailleurs à démissionner d’eux-mêmes.
En plus de cela, Musk a collecté des informations. Il a lâché une petite armée d’ingénieurs de la Silicon Valley à ses ordres, qui a envahi les grands ministères et pillé leurs fichiers, prenant possession des données personnelles et financières de millions de personnes. Il semble qu’ils aient également copié les données sur les plans de paiement de programmes importants et téléchargé les codes nécessaires pour autoriser des paiements. On ne peut qu’imaginer ce qu’ils pourraient faire avec toutes ces données. Trouver les adresses d’immigrants que l’ICE[1] n’a pas réussi à attraper ?
Trump a ensuite adopté une série de décrets (executive orders), sans doute pour donner une apparence de légalité à tout ce chaos. Durant ses deux premiers mois d’exercice, il a ainsi adopté pas moins de 107 décrets réduisant les effectifs, voire éliminant des secteurs entiers dans des services publics vraiment essentiels : les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l’administration chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments (FDA), l’Institut de la recherche biomédicale et de la santé publique (NIH), l’agence chargée de l’étude des océans et de l’atmosphère (NOAA), l’agence chargée de gérer les situations d’urgence et les catastrophes naturelles (FEMA), la poste, l’aménagement du territoire, l’Agence de protection de l’environnement (EPA), et même l’Agence de réglementation de l’aviation civile (FAA), entre autres… Ses coups de hache ont également visé les principaux services sociaux, tels que les hôpitaux destinés aux vétérans de l’armée, les dispositifs Medicaid (assurance maladie destinée aux personnes ayant de faibles revenus), Medicare (assurance maladie destinée aux personnes de plus de 65 ans) et le paiement des retraites. Les baisses d’effectifs dans les programmes sociaux et les services publics signifient des coupes dans les services fournis.
Les suppressions d’emplois et les coupes dans les services publics n’ont pas commencé avec Trump. La poste connaît depuis longtemps des sous-effectifs, son service de distribution du courrier est réduit. Des dizaines de milliers de travailleurs étaient déjà sans retraite fédérale, par exemple parce qu’ils étaient absents lors du passage d’un agent ou n’étaient pas en mesure de corriger des erreurs dans leur dossier. Quant aux hôpitaux destinés aux anciens combattants, leur manque d’effectifs et leur sous-équipement sont tels que les patients doivent parfois attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous, même lorsqu’ils présentent des tendances suicidaires. Il y a si peu d’inspecteurs du travail que la plupart des grandes usines ne font l’objet d’un contrôle que tous les quatre ou cinq ans, si elles sont contrôlées, et que les petites usines ne le sont jamais. Il n’y a pas assez de juges-arbitres pour assurer les audiences d’appel des travailleurs qui sont licenciés à la suite d’une campagne de syndicalisation, si bien que même lorsque ces travailleurs sont réintégrés, la campagne est souvent interrompue. Et ce ne sont que quelques exemples. Ces coupes dans les budgets publics font partie des attaques qui ont tiré le niveau de vie des travailleurs états-uniens vers le bas depuis quarante ans.
Mais la course folle de Trump pour supprimer le plus de dépenses possible risque de cannibaliser complètement les services publics dont toute société moderne a besoin. C’est le type de destruction dont le capital financier est coutumier lorsqu’il prend les commandes d’une entreprise : taille dans le vif, licenciements en masse, vente des actifs facilement liquidables, neutralisation du reste et génération de profits énormes en se payant sur la bête.
Le seul domaine où la nouvelle administration n’a pas procédé à des coupes budgétaires, c’est le noyau de l’État, c’est-à-dire les forces de répression : le Pentagone, l’armée, le ministère de la Sécurité intérieure, les prisons, le ministère de la Justice et les camps d’internement, tout ce qui constitue la partie dite régalienne de l’État, et ses dépenses.
Trump et Musk affirment chasser la fraude, le gâchis et les abus. Ainsi, ces milliardaires insatiables, qui ont accumulé leur fortune grâce à des aides de l’État, osent prétendre qu’ils veulent rendre l’État plus efficace ? Non, ils ne cherchent pas à augmenter l’efficacité. Tout ce qu’ils veulent, c’est réduire autant que possible le contrôle que l’État exerce sur l’économie, c’est-à-dire ce qu’ils appellent la régulation. De fait, la seule « régulation » qu’ils acceptent est celle qui sert les intérêts généraux de la classe capitaliste. Mais, durant les dernières décennies, avec la crise, les capitalistes ont de plus en plus eu recours à l’État pour sauver leurs entreprises, et les montants affectés aux autres postes du budget se sont effondrés. Les effectifs employés par l’administration fédérale ont chuté et, avec eux, la régulation exercée sur l’économie. Les coupes que Trump a en vue sont donc dans la continuité des fortes coupes antérieures. Elles n’en auront pas moins des conséquences sur la population, avec une poursuite de la dégradation de l’environnement, des conditions et de la sécurité au travail, de la salubrité, de la santé, etc.
L’administration Trump affirme qu’elle supprime des dépenses superflues voire frauduleuses. Trump répète les mensonges d’influenceurs d’extrême droite sur les réseaux sociaux, comme Laura Loomer, qui affirme qu’il y a des dizaines de milliers de morts qui continuent de percevoir la retraite fédérale et des millions d’immigrants qui perçoivent des allocations alors qu’ils n’ont versé aucune cotisation. Oui, il y a bien de la fraude et du gaspillage dans les finances publiques. Mais le gâchis est à rechercher dans toutes ces subventions, ces exonérations d’impôts et autres cadeaux qui accroissent les profits de la classe capitaliste. Il suffit de penser à la réduction d’impôts de 4 300 milliards de dollars mise en œuvre par Trump lors de son premier mandat. La plupart des baisses mises en place arrivent à échéance le 31 décembre 2025. Trump a promis de les reconduire. Cette nouvelle version des baisses d’impôts, comme la précédente, profitera d’abord aux plus riches et aux grandes entreprises qui en tirent leur fortune. Et, comme la précédente, elle sera payée par la classe ouvrière. Le discours sur les morts et les immigrants percevant des allocations n’est rien d’autre qu’un écran de fumée pour cacher le véritable vol à grande échelle perpétré par la classe de Trump avec l’aide active du gouvernement des États-Unis.
Avec ses innombrables décrets, Trump a affiché les principaux objectifs du programme de l’extrême droite aux États-Unis. La vitesse à laquelle il l’a élaboré, les violentes critiques qu’il a adressées à quiconque chercherait à le remettre en question, notamment à l’encontre des juges, tout cela manifeste la détermination de l’extrême droite à ne tolérer aucun obstacle, maintenant qu’elle a un de ses hommes à la Maison Blanche. Il n’est pas certain que le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat par le Parti républicain permette à l’extrême droite d’obtenir ce qu’elle veut : la voie parlementaire classique est en effet trop lente, trop ouverte aux débats et aux marchandages, voire à la pression de l’opinion publique, comme le montrent actuellement les élus républicains eux-mêmes. Les décrets présidentiels sont bien plus simples et rapides. Certes, ils peuvent être à la limite de la légalité. Et ceux de Trump le sont souvent, comme lorsqu’il a prétendu ignorer les dispositions de la Constitution qui définissent la citoyenneté. Jusqu’ici, les tribunaux semblent avoir ralenti le rouleau compresseur de Trump, mais ils ont veillé à ne le faire que temporairement. Rien n’indique que l’action des tribunaux soit capable de l’arrêter, en tout cas pas tant qu’il conserve un large soutien de la classe capitaliste. Et rien n’indique pour l’instant qu’il ait perdu ce soutien, même si le scandale de la fuite d’informations confidentielles sur Signal l’a un peu déstabilisé, et même si ses annonces d’avril sur les droits de douane ont mis Wall Street franchement en colère. Malgré cela, il n’y a pas encore d’appel à sa destitution venant de porte-parole de la bourgeoisie, contrairement à ce qui s’était passé lors de son premier mandat. Mais, bien sûr, tout cela peut changer. La bourgeoisie a d’autres moyens que la destitution pour se débarrasser d’un homme politique. La chute de Trump pourrait être aussi rapide que la suppression de ministères à laquelle nous avons assisté en ce début de second mandat. Qu’il s’en souvienne ou non, c’est bien la bourgeoisie qui le tient en laisse, et non l’inverse.
Il est d’ailleurs possible que Trump soit maintenant un peu inquiet, si l’on en juge par les allusions que lui et son vice-président ont soudain faites sur la fin prochaine de l’ère Musk. Trump doit considérer qu’il est préférable de sacrifier Musk plutôt que de tomber lui-même.
Politique étrangère : imposer la domination des États-Unis sur le reste du monde
Malgré quelques changements évidents, la politique étrangère de l’administration Trump n’est rien d’autre qu’une version réchauffée des politiques qui l’ont précédée. Son principal objectif demeure de renforcer la domination de l’impérialisme américain sur le monde. Cette domination est garantie, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par l’énorme différence entre les ressources militaires des États-Unis et celles de chacun des autres pays de la planète, par la taille de leur marché intérieur, par le contrôle qu’ils exercent sur tant de matières premières essentielles et bien sûr par leur puissance financière, qui se manifeste par le rôle clé du dollar dans les échanges internationaux.
Mais la politique de Trump présente tout de même une différence par rapport à celles qui l’ont précédée : avant Trump, les États-Unis recouraient à des chemins détournés pour imposer leurs intérêts lors des négociations avec d’autres pays ; Trump, lui, tord le bras au reste du monde et le met en scène.
Ainsi, les États-Unis s’emploient depuis longtemps à affaiblir l’Europe. Ils sont à l’origine, d’abord sous Obama, puis sous Biden, d’un conflit qui s’est transformé en guerre ouverte en Ukraine : l’Europe s’est alors vue privée de l’énergie et des céréales bon marché ukrainiennes, ce qui a entraîné une récession en Allemagne. L’Europe a été contrainte de respecter les sanctions imposées à la Russie et, à cause du blocage du gazoduc Nord Stream 2 puis l’explosion enregistrée sur Nord Stream 1, elle a dû acheter son pétrole et son gaz aux États-Unis, à des prix bien plus élevés, de même que les armes qu’elle était contrainte de leur acheter pour les livrer aux forces ukrainiennes.
L’affaiblissement de l’Europe face aux États-Unis n’est donc pas nouveau. Mais la manière dont la chose est présentée publiquement est nouvelle… et choquante. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Vance, le vice-président des États-Unis, s’est lancé dans une diatribe contre l’Europe qu’il accuse de vivre aux crochets des États-Unis.
On retrouve la même arrogance dans la manière dont Trump semble déchirer les alliances politiques internationales. Par exemple, la discussion largement médiatisée entre Trump, Vance et Zelensky s’est transformée en réprimande en règle de Zelensky. Le message n’était pas seulement adressé à ce dernier mais au monde entier : les États-Unis de Trump feront exactement ce qu’ils veulent. Habituez-vous à vous faire humilier publiquement !
En outre, la politique des États-Unis vis-à-vis de la Russie a changé brusquement avec Trump. Contrairement à ce qu’affirment certains médias aux États-Unis, cela ne signifie pas que Poutine manipule Trump. Il est évident que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui sont à l’origine du changement, et non la Russie. De même, il est évident que, sous Trump comme sous n’importe quelle autre administration, les États-Unis pourraient refaire de la Russie un paria. Trump commence d’ailleurs déjà à montrer que leur « amitié » n’est pas si bien ancrée que cela. D’autres médias ont prétendu que ce changement s’expliquait par les affinités supposées entre deux dirigeants qui se présentent comme des hommes forts. Mais Trump n’est pas le premier à chercher à utiliser la Russie (et, avant elle, l’Union soviétique) pour maintenir la stabilité dans la sphère d’influence de l’impérialisme américain. Dans la période actuelle, il peut s’agir pour lui d’enfoncer un coin entre la Russie et la Chine, du fait du poids économique croissant de cette dernière. Quoi qu’il en soit, ces changements montrent la volonté de l’impérialisme américain de contraindre le reste du monde à se plier à sa volonté.
C’est certainement ce que manifestent les annonces de Trump sur les droits de douane. Il n’est pas certain que Trump veuille vraiment aller jusqu’au bout en la matière, malgré son spectacle télévisé du 2 avril pour lancer le « jour de la libération ». Comme la presse économique l’a remarqué, il ne semble pas y avoir la moindre réalité économique derrière les chiffres colorés présentés par Trump et Howard Lutnick, son secrétaire d’État au Commerce, devant les caméras.
Il est possible que les annonces de Trump soient d’abord motivées par son désir narcissique de rester au centre de l’attention, comme il l’a fait pendant une heure et demie lors du « jour de la libération », devant une assemblée de thuriféraires composée de membres du gouvernement et d’autres personnalités officielles, ainsi que d’une poignée de routiers et de deux douzaines d’ouvriers de l’automobile en tenue de travail.
Les préparatifs du « jour de libération » pourraient n’avoir été qu’un stratagème destiné à déterminer le niveau des concessions qu’il était possible d’arracher aux autres pays. Trump l’a lui-même reconnu : « Tous les pays nous appellent. C’est la beauté de ce que nous faisons. Nous sommes aux commandes. Si nous avions demandé à ces pays de faire des concessions, ils auraient refusé. Mais, maintenant, ils feront n’importe quoi pour nous ! » Bien sûr, ces propos vantards, le jour où les marchés étaient sur le point de s’effondrer, étaient peut-être destinés à montrer qu’il n’était pas inquiet et que les marchés n’avaient pas de raison de l’être non plus.
Les annonces de Trump sur les droits de douane peuvent très bien avoir été également destinées à obtenir des avantages de la part d’autres pays sur des questions non tarifaires, comme dans le cas du Groenland. Trump a beau avoir l’air d’un enfant capricieux lorsqu’il crie qu’il veut le Groenland, cela fait longtemps que les États-Unis œuvrent à obtenir des garanties pour exercer un contrôle direct sur ce pays. Leur armée l’utilise comme base militaire depuis 1941, et elle la considère depuis lors comme l’une de ses bases les plus importantes. Dans un contexte où la situation politique mondiale se tend, il est plausible que l’état-major veuille exercer un contrôle de plus en plus étendu sur cette région. Quant aux minerais évoqués, ils sont juste la cerise sur le gâteau.
Le monde est accablé par des conflits, tant économiques que politiques, qui le mettent sur la voie d’une nouvelle guerre mondiale. Ce n’est pas Trump qui a donné naissance à ces conflits, et il n’a pas non plus véritablement changé la politique des États-Unis face à ces conflits. Il en a seulement exposé un certain nombre au grand jour.
Trump mettra-t-il en œuvre une politique étrangère plus isolationniste ? C’était à la fois l’un de ses thèmes de campagne et l’objectif de nombre de courants d’extrême droite que Trump a rassemblés autour de lui. Ils veulent se débarrasser de ce qu’ils appellent les « embrouilles avec l’étranger ». Mais, depuis que Trump est élu, chaque fois qu’il prononce une phrase dans ce sens, il en prononce deux pour réaffirmer la continuité avec la politique étrangère de ses prédécesseurs. Son agressivité vis-à-vis du Groenland, du Canada et du Panama n’exprime pas vraiment la position d’un pays adoptant une position isolationniste, bien au contraire. Trump a accru les bombardements sur le Yémen et apporte un soutien sans faille à l’expansion militaire israélienne au Moyen-Orient. En outre, il ne réduit pas les dépenses militaires, il les augmente. En réalité, Trump est le dernier avatar d’une longue série de partisans de l’expansion militaire de l’impérialisme des États-Unis ; sous des dehors isolationnistes, il est en fait en train de préparer la guerre.
Quant aux droits de douane, ils n’ont pas commencé avec Trump. Ils augmentent dans le monde entier, à un rythme inégalé depuis la crise de 1929. Ils sont l’expression de la crise économique elle-même. Lorsque la taille du gâteau diminue, chaque capitaliste s’appuie de plus en plus sur son propre État pour défendre ses intérêts. Les travailleurs du monde entier en paieront le prix, et ce prix va augmenter à l’avenir.
Dans son style égocentrique, Trump a certainement aggravé la situation. L’économie mondiale n’a pas la capacité d’absorber le choc considérable que ces droits de douane entraîneront. La chute rapide des cours boursiers, un recul de 6 000 milliards de dollars dans les deux jours qui ont suivi les annonces de Trump, montre d’abord le niveau de la spéculation pratiquée dans les salles de marché. Mais elle exprime aussi la conscience des capitalistes des États-Unis du niveau d’interconnexion et de vulnérabilité de leur propre économie, ainsi que des risques entraînés par la décision de Trump. Celui-ci peut très bien avoir joué à bousculer leurs intérêts juste pour voir ce qui arriverait, comme il le fait souvent. Mais le fait qu’un égocentrique plutôt instable dirige l’appareil d’État de l’impérialisme le plus puissant montre le degré de folie auquel le capitalisme amène le monde aujourd’hui. D’après Warren Buffett, l’un des milliardaires les plus riches du monde, « Les droits de douane sont des actes belliqueux, à un certain niveau. S’ils ne font pas couler du sang tout de suite, il ne faut pas s’y tromper, ils constituent un acte d’agression qui appelle des représailles. »
Mettre au pas la population
Certains décrets de Trump visent spécifiquement des personnes impliquées dans les protestations du printemps dernier contre les politiques des États-Unis, et notamment contre le soutien et l’implication de ces derniers dans la guerre qu’Israël mène à Gaza, ou encore contre la guerre de facto que l’exécutif des États-Unis mène contre les migrants illégaux.
Un étudiant palestinien de l’université Columbia qui possédait un permis de séjour aux États-Unis a été arrêté en raison de son rôle lors des manifestations sur les campus au printemps dernier. Sa carte verte a été annulée sans qu’il puisse être entendu par la justice. Une étudiante turque de l’université Tufts (dans le Massachusetts) a été arrêtée – en fait, elle a été abordée dans la rue et littéralement enlevée par des agents de l’ICE, la police de l’immigration – pour avoir écrit au printemps un article critiquant la politique d’Israël à Gaza et avoir appelé son université à cesser tout investissement en Israël. Son visa d’étudiante a été annulé et elle n’a même pas eu la possibilité de se défendre. Sept étudiants d’autres pays, dont certains bénéficiant de bourses Fulbright (système fédéral de bourses d’études « au mérite »), ont été arrêtés, et ont vu leur visa étudiant annulé, là encore sans possibilité d’être entendus. Tous avaient un niveau d’étude élevé et un très bon CV. Le message était clair : si cela peut arriver à des gens comme eux, cela peut arriver à n’importe qui. Tout étudiant originaire d’un autre pays était prévenu : réfléchis à deux fois avant de dire ou d’écrire quelque chose.
Lorsque les protestations ont commencé l’année dernière, d’autres étudiants, de nationalité américaine, ont vu toutes leurs données personnelles divulguées sur internet. Leur adresse, celles de leurs parents et de leurs proches, leur adresse électronique, numéro de téléphone, des informations sur leur vie privée, tout cela a été jeté en pâture dans la jungle des réseaux sociaux, avec des résultats prévisibles : eux, leurs parents et leurs proches ont été victimes de harcèlement et de menaces. L’opération fut apparemment orchestrée par des organisations d’extrême droite telles que Canary Mission, mais ce type d’intimidation porte la signature de Trump. Il est aussi derrière les sanctions disciplinaires infligées par l’université Columbia (à New York) à ceux de ses étudiants qui ont manifesté. Divulgation de données personnelles, annulation de diplômes ou encore de crédits d’heures correspondant à des travaux effectués : tout cela était un avertissement pour tout étudiant qui envisagerait de protester contre la politique des États-Unis.
Certaines mesures de l’administration n’ont pas d’autre but que de susciter dans la population une peur vis-à-vis de personnes présentées comme différentes. C’est ce que montre par exemple le traitement infligé aux migrants originaires du Venezuela, dont certains ont été arrêtés, accusés d’être membres d’un groupe criminel et, sans preuve ni audience publique, expulsés et jetés dans une prison tristement célèbre au Salvador, le crâne rasé, le corps dénudé pour faire apparaître leurs tatouages. Ils ont été exposés comme des animaux en cage. C’est comme si l’on avait écrit sur leur front « dangereux criminel ».
Pour aggraver encore leur dégradation symbolique, Kristi Noem, secrétaire d’État de Trump à la Sécurité intérieure, est passée en coup de vent dans cette prison avec une montre Rolex à 50 000 dollars et des vêtements moulants, avant tout pour se faire un nom. Les prisonniers, entassés à douze dans une minuscule cellule, n’étaient que la toile de fond du message qu’elle a aboyé à la face du monde : « Si vous tentez de franchir illégalement la frontière des États-Unis, vous atterrirez vous aussi dans cette prison ignoble ! »
Les unes après les autres, les franges les plus fragiles de la population sont attaquées, ses membres traités comme des pestiférés et présentés comme les ennemis du reste de la population : les partisans de Trump présentent ainsi les femmes trans comme réclamant à grands cris de participer aux compétitions sportives en tant que femmes afin de fausser la compétition. Dans leur propagande, les Noirs sont les grands bénéficiaires d’un « racisme antiblancs ». Enfin, ils affirment que les immigrants « illégaux » franchissent la frontière pour prendre les emplois des travailleurs américains ou s’adonner à des activités criminelles.
Trump prétend redonner à l’Amérique la « grandeur » de l’époque de William McKinley, président des États-Unis entre 1897 et 1901. Cette période, surnommée celle des barons voleurs, fut celle de l’explosion de l’exploitation et, conjointement, de la fortune d’une bourgeoisie pétrie de cupidité et en pleine ascension, qui rejoignait les bourgeoisies européennes dans la compétition pour se partager le reste du monde. C’est aussi une période où les Noirs étaient victimes de lynchages dans les campagnes du Sud, où des bandes « nettoyaient » les quartiers de la présence de Noirs dans les villes du Nord, où la Légion américaine[2] ciblait les travailleurs qui cherchaient à implanter un syndicat, pour les chasser de la ville, couverts de goudron et de plumes. C’est une Amérique dans laquelle différentes catégories de la population étaient montées les unes contre les autres et mises en concurrence par la pénurie d’emplois, de logements, etc.
De la même façon, Trump aimerait monter différentes couches de la population les unes contre les autres, pour mieux dissimuler la seule division essentielle, celle entre les travailleurs et la bourgeoisie. Cette vieille ficelle, la bourgeoisie la ressort de son chapeau aujourd’hui, alors même qu’elle commence une guerre commerciale qui pourrait se transformer en nouvelle guerre mondiale.
Le trumpisme est-il un fascisme ?
Avons-nous affaire à du fascisme, ou du moins à une sorte de préambule au fascisme ? Ou s’agit-il d’un retour du maccarthysme[3] ?
Il est évident que Trump est plus autoritaire que les présidents précédents. Avec sa grosse centaine de décrets, il a court-circuité le Congrès. Il a montré sa capacité à ignorer purement et simplement des décisions judiciaires. Il s’est attaqué à de nombreux domaines présentés comme des symboles de la démocratie : la presse, les universités, les grands cabinets d’avocats, les syndicats, ceux qui représentent la liberté de la presse, d’expression ou d’association, le droit de s’organiser, ou encore le droit des citoyens d’être représentés par un avocat.
La rapidité avec laquelle Trump a créé des précédents et s’est attribué des pouvoirs qui ne lui reviennent pas légalement, et ce sans difficulté pour l’instant, montre que la situation politique pourrait changer très vite. Autrement dit, nous pourrions être à la veille d’un nouveau maccarthysme ou d’un retour du fascisme.
Un grand nombre des décrets adoptés par Trump visent à mettre au pas la population, ce qui laisse présager une intensification de la répression.
Dans le même temps, il est important de comprendre que ces décrets s’appuient sur une vaste opération de manipulation. On le voit clairement dans la manière dont l’administration Trump prétend expulser les immigrants, qu’ils aient ou non des papiers. Il n’arrête pas de répéter que le pouvoir va attraper un million d’immigrants en ratissant la population. Mais, de fait, l’appareil d’État qui serait nécessaire pour accomplir une telle tâche n’existe pas. Ou, en tout cas, pas encore. Aujourd’hui, six hommes masqués peuvent enlever une femme turque dans la rue en plein jour, et l’événement peut être diffusé à la télévision. Ils peuvent attraper quelques dizaines de Vénézuéliens, les mettre nus pour montrer leurs tatouages, les expulser pour les incarcérer dans une prison salvadorienne, et noyer les médias d’histoires horribles sur cette prison afin de faire comprendre à chaque immigrant qu’il pourrait finir là. Ils peuvent recourir à des mesures administratives, déclarant par exemple que plusieurs milliers de migrants – illégaux ou non, personne ne le sait – sont morts et mettant leurs données fiscales et de sécurité sociale sens dessus dessous. Oui, ils peuvent faire tout cela. C’est une sorte de campagne destinée à cadrer et terroriser les gens, pour qu’ils s’en aillent. Mais l’appareil d’État dans son ensemble ne s’est pas (encore) mis en branle pour rafler les immigrants à grande échelle. Trump agit de la même manière avec les universités, les cabinets d’avocats et les grands médias.
Tout cela ne signifie pas, loin de là, que Trump est porté par une vague fasciste. Trump s’est drapé du manteau de la « présidence impériale ». S’appuyant sur l’article 2 de la Constitution, qui stipule que le président incarne le pouvoir exécutif, Trump a dit et répété maintes fois que cela signifie qu’il peut faire ce qu’il veut. En réalité, il répond à un problème auquel la bourgeoisie est confrontée depuis longtemps, à savoir que le système politique du pays ne permet pas de prendre des décisions rapidement. Ce problème est d’autant plus brûlant alors que la crise économique dure, que la concurrence s’accroît entre pays et que les guerres se multiplient dans le monde. Les processus de prise de décision sont répartis entre plusieurs acteurs, tant sur le plan géographique qu’institutionnel. Le pays est divisé en instances de décision locales (villes et comté), intermédiaires (États) et centrale au niveau fédéral. Comme l’a montré la question de la légalité de l’avortement, cette organisation tend à empêcher l’adoption d’une approche et d’une décision communes.
L’État fédéral, divisé en trois instances, exécutive, législative et judiciaire – division que l’on retrouve en général au niveau de chacun des 50 États fédérés – finit souvent par ne pas pouvoir adopter une décision ; il apparaît comme un magma dans lequel des appareils en concurrence se bloquent mutuellement. Alors que le monde connaît des changements rapides, la structure politique demeure, au moins formellement, celle mise en place en 1787, lorsque la Constitution fut adoptée. En conséquence, la fameuse séparation des pouvoirs dans laquelle trois pouvoirs prétendument égaux s’équilibrent mutuellement, dont tous les enfants ont entendu parler à l’école, a cédé la place à un pouvoir exécutif qui s’est considérablement renforcé au détriment des deux autres. On le voit sur la question de la guerre. D’après la Constitution, le Congrès déclare la guerre, après quoi le pouvoir exécutif la mène, et le pouvoir judiciaire veille à ce que cela se fasse dans le respect de responsabilités bien définies. Mais quand le Congrès a-t-il effectivement déclaré la guerre pour la dernière fois ? En Corée ? Non, il s’agissait officiellement d’une simple « opération de police ». Au Vietnam ? Non plus, la résolution du golfe du Tonkin, adoptée en 1964, n’était pas vraiment une déclaration de guerre, et elle a été prise plusieurs années après que les troupes américaines eurent tiré leurs premiers missiles. En Irak, peut-être ? Non plus. En Afghanistan, pas davantage. En Syrie ? Y a-t-il eu une guerre américaine en Syrie ? Et que dire de toutes ces guerres financées par les États-Unis et conduites par d’autres, en Israël, en Ukraine ou au Liban ?
Que l’on pense encore au rôle de la Cour suprême, censée contrôler le président. Dans la mesure où ses membres sont nommés par le président lui-même, il est probable qu’ils seront enclins à adopter son point de vue, y compris en lui accordant une immunité totale, comme ils l’ont déjà fait pour Trump. Pensons encore à l’avortement : la Cour suprême l’a légalisé par un arrêt rendu en 1973, et a annulé ce même arrêt en 2022.
La structure politique et les règles de la Constitution ont, de fait, été souvent ignorées, à chaque fois que le pays faisait face à une crise grave. Ainsi, alors qu’on était au bord d’un effondrement économique en 2008, Bush, sur le point de partir, et Obama, pas encore en poste, se sont réunis avec quelques banquiers et la Réserve fédérale (la banque centrale des États-Unis) pour remettre les marchés financiers d’aplomb. Le Congrès et le pouvoir judiciaire n’ont simplement pas eu leur mot à dire.
Ce que Trump fait actuellement, c’est simplement pousser encore plus loin cette tendance, qui n’est pas nouvelle. Avec ses décrets, il est en train d’imposer son droit à agir à la fois en tant que président et avec les prérogatives du Congrès et du pouvoir judiciaire.
Affirmer que Trump ne peut pas être caractérisé comme fasciste ne signifie pas que le fascisme ne pourrait pas se développer aux États-Unis. Mais notre préoccupation est de déterminer la nature de la situation à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Nous observons une intensification des attaques contre la population sur le plan économique, un accroissement de la violence des forces de répression organisées par l’État et une tendance à présenter le vote démocrate comme la réponse à cette situation. Aujourd’hui, cette tendance constitue le plus grand danger pour la classe ouvrière.
Il y aura des attaques
Jusqu’où les attaques contre le niveau de vie et le durcissement de la répression peuvent-ils aller ? Cela ne dépend pas de Trump, mais du rythme tant de l’aggravation de la crise économique que de l’accroissement de la concurrence entre pays.
Il y aura des attaques. Et c’est la classe ouvrière qui sera la principale cible, comme on peut le voir avec la guerre commerciale qui est en train de se développer. Les droits de douane sont un nouvel impôt, particulièrement rétrograde, qui va tailler dans le niveau de vie de celles et ceux qui disposent des revenus les plus bas. Si la guerre commerciale se développe à grande échelle, les suppressions d’emplois vont frapper des pans entiers de la classe ouvrière.
Pour ce qui est de la répression, quelle que soit sa nature, elle sera exercée contre la classe ouvrière car celle-ci est la force sociale qui a le pouvoir de mettre un terme à ce système qui produit des catastrophes comme le chômage, l’inflation, les guerres commerciales et les guerres tout court.
Aujourd’hui, la classe capitaliste est mieux préparée pour cette guerre que ne l’est la classe ouvrière. De fait, la mise en scène de Trump en « président impérial » fait partie de cette préparation, elle indique que la bourgeoisie est prête, si la situation l’exige, à ne pas s’appuyer uniquement sur la dictature économique qu’elle exerce sur le reste de la société, mais également sur la dictature politique exercée par un individu, s’il devient nécessaire d’accroître le niveau de la répression. Cela ne signifie pas que les capitalistes pensent que Trump sera cet homme. C’est juste lui qui est en position aujourd’hui d’élever le niveau de répression d’un cran.
Quelle que soit la manière dont la situation évolue, la classe ouvrière ne pourra compter que sur elle-même. Et, aujourd’hui, elle n’est pas préparée. Elle ne possède pas son propre parti politique, elle ne s’est pas organisée pour participer sur ses propres bases aux luttes politiques pour y défendre ses intérêts spécifiques. Elle n’a guère mené la lutte syndicale, sous les formes très restreintes autorisées par les conventions signées par les syndicats et dans les limites d’une législation antiouvrière qui empêche les travailleurs de s’organiser en tant que classe.
Pis, la plupart des responsables syndicaux se sont efforcés de lier les travailleurs au Parti démocrate. Certains d’entre eux se mettent à présent à la remorque de Trump, ils se réjouissent de ses annonces sur les droits de douane et sur la criminalisation des immigrants. Le fait qu’ils puissent soutenir à la fois les politiques des démocrates et de Trump n’est pas contradictoire. Dans les deux cas, ils attachent les travailleurs, pour autant qu’ils exercent encore une influence sur eux, à la bourgeoisie, que défendent tant les démocrates que Trump et son parti.
Il est clair que les démocrates chercheront à convaincre que Trump est le problème et qu’il faut donc se débarrasser de lui. Bernie Sanders, qui est en tournée nationale, fait campagne contre « l’oligarchie ». Il attire à lui certains de ceux qui veulent se battre et fait office de rabatteur pour le Parti démocrate.
Tout cela fait reculer la classe ouvrière. Les manifestations du 5 avril ont montré combien les objectifs affichés par les démocrates peuvent être réactionnaires, en offrant une diversion aux gens qui veulent se battre[4].
C’est pourquoi il est si important que les révolutionnaires plantent aujourd’hui un drapeau auquel puissent se rallier les travailleurs et toutes celles et ceux qui lient leur sort à celui de la classe ouvrière. Il faut un drapeau pour tous ceux qui ont peur et qui en ont assez, pas seulement de Trump, mais de ce système capitaliste pourri et puant. Plus que jamais, nous devons affirmer que la classe ouvrière a besoin de son propre parti et de son propre programme. Car elle seule a le pouvoir de sauver la société de la barbarie à laquelle le capitalisme est en train de conduire l’humanité.
Nous savons que nous serons minoritaires en adoptant cette position. Plus exactement, nous serons une minorité au sein de la minorité. Parfois, faire face à une telle situation est plus difficile que d’affronter la répression.
6 avril 2025
[1] Immigration and Customs Enforcement : agence de police douanière et de contrôle des frontières (note LDC).
[2] Organisation d’anciens combattants créée en 1919, anticommuniste et antisyndicale, qui organisa des expéditions punitives et des campagnes d’intimidation (note LDC).
[3] Chasse aux sorcières organisée de 1950 à 1954 à l’instigation du sénateur républicain McCarthy contre toute personne soupçonnée d’avoir ne serait-ce que des sympathies communistes (note LDC).
[4] Le 5 avril ont eu lieu les plus grandes manifestations anti-Trump depuis son arrivée au pouvoir (note LDC).