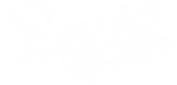La dette, un des moteurs de l’émergence du capitalisme
L’endettement des États a accompagné et financé le développement de l’économie capitaliste depuis son émergence au sein du système féodal de quelques pays d’Europe. Il a constitué une arme précieuse pour les différentes bourgeoisies pour la construction d’appareils d’État dévoués à leurs intérêts de classe. Si, au 15e siècle, Jacques Cœur, homme d’affaires et banquier, avait pu devenir Grand argentier du roi de France, s’enrichissant en même temps par les prêts qui finançaient le budget et les armées royales, il a été jeté en prison peu après : une façon rapide et commode pour l’État monarchique de ne pas payer ses dettes.
Mais cette même bourgeoisie, tout comme sa devancière britannique, prospéra très largement par la suite, grâce à la politique de conquête coloniale des monarchies d’Europe, à l’asservissement des populations, à la traite négrière et au pillage des richesses et des terres conquises par les armées royales à fonds perdu. Perdus peut-être, mais pas pour tout le monde ! La dette publique alimentait déjà largement les coffres-forts de la bourgeoisie. Elle devenait, selon les termes de Marx, « l’un des leviers les plus énergiques de l’accumulation initiale. Comme par un coup de baguette magique, elle confère à la monnaie improductive un talent procréateur qui la transforme en capital, sans qu’il ait besoin de s’exposer au dérangement et aux risques des investissements industriels ni même des placements usuraires. »[1] Ce mécanisme favorisa simultanément la naissance des sociétés par actions, des activités spéculatives et de la « bancocratie » moderne.
Trois siècles plus tard, c’est la bourgeoisie et la Révolution française qui, grâce à l’intervention des masses pauvres urbaines et des campagnes, chassaient la noblesse, dont le parasitisme et les dettes insolvables avaient conduit à une véritable banqueroute. À la fin des années 1780, le seul paiement des intérêts de ces dettes représentait entre le tiers et la moitié du budget de la monarchie française. Au point qu’un Mirabeau pourra prétendre : « La dette publique a été le germe de notre liberté », « notre » s’entendant comme celle des nouveaux maîtres du pouvoir. Et c’est finalement la création massive de papier-monnaie, notamment les assignats, et l’inflation massive qui soldèrent en quelque sorte les dettes de l’Ancien Régime, au profit des plus riches bourgeois.
L’ère de l’impérialisme et du capitalisme triomphant
Marx, puis Rosa Luxemburg et Lénine notamment ont démonté, pour mieux les combattre, les mécanismes à travers lesquels le capital financier avait mis la planète en coupe réglée de façon généralisée à partir du milieu du 19e siècle. Les capitaux en surplus dans les citadelles du capitalisme permirent d’intégrer au marché mondial des régions entières qui lui échappaient jusque-là. Elles furent soumises à la loi du profit, c’est-à-dire au pillage et à l’exploitation, par les grandes puissances et leurs entreprises.
Les dettes constituaient un moteur puissant de cette domination. À l’intérieur même des nations capitalistes tout d’abord, grâce à des appareils d’État qui empruntaient massivement pour financer les réseaux de chemins de fer et certaines infrastructures urbaines indispensables aux industriels. Mais le marché international des emprunts, c’est-à-dire la vente des titres de dettes (ou bons du Trésor), était également une arme d’asservissement puissante. L’Amérique latine, l’Empire ottoman en pleine déliquescence, devinrent ainsi des semi-colonies des puissances impérialistes, les crédits octroyés à ces pays permettant au Royaume-Uni ou à la France d’exercer une domination économique, militaire et politique quasi absolue. Comme le résumait Rosa Luxemburg, en lutte contre les positions colonialistes d’une partie de la social-démocratie allemande, les emprunts constituaient « le moyen le plus sûr pour les vieux pays capitalistes », principalement la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et la Belgique, « de tenir les jeunes pays en tutelle, de contrôler leurs finances et d’exercer une pression sur leur politique étrangère, douanière et commerciale ».[2]
À la fin du 19e siècle, l’autocratie tsariste dut à son tour « téter goulûment les tétines de la Bourse de l’Europe occidentale » (Trotsky). Les emprunts russes financèrent l’industrialisation à marche forcée de la Russie sous l’emprise de l’impérialisme, ainsi qu’une politique d’armement massive, à l’instar de la construction de voies ferrées destinées à acheminer des troupes à l’ouest dans la perspective de la guerre contre l’Allemagne préparée par la France. Mal en prit aux financiers européens, et surtout aux petits épargnants qui avaient cru aux promesses d’un rendement garanti dans la « Russie éternelle » : les bolcheviks en appelèrent à une « insurrection générale contre les capitalistes » et refusèrent de reconnaître les dettes de l’ancien régime après la révolution d’Octobre, comme ils s’y étaient engagés depuis le Révolution de 1905.
Les investissements massifs dans la production de navires de guerre, de canons, de munitions, puis la Première Guerre mondiale portèrent les dettes des États à des niveaux jamais atteints. En France, le volume de la dette publique fut ainsi multiplié par six entre 1913 et 1918. Au lendemain de cette lutte à mort pour un repartage du monde, les dettes de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni représentaient deux à trois fois leur PIB. De fait, elles ne furent pas véritablement remboursées, mais elles changèrent la hiérarchie entre les puissances capitalistes, les États-Unis devenant, et jusqu’à ce jour, le « patron de l’Europe » (Trotsky) et le financier en chef. Quant à l’Allemagne, que les impérialismes français et britannique entendaient « faire payer » en imposant une masse supplémentaire de dettes de guerre, sa population fut très largement ruinée par l’hyperinflation de 1923 puis, de nouveau, par les effets dévastateurs de la crise déclenchée aux États-Unis en 1929. Un effondrement qui, en raison de la politique des partis socialiste et communiste, permit à Hitler d’accéder au pouvoir sans avoir à combattre la classe ouvrière la plus puissante d’Europe et enclencha la marche vers la Deuxième Guerre mondiale. Au même moment, la politique du New Deal aux États-Unis creusait considérablement la dette publique. Loin de résoudre la crise, cela ne fit que mener à « une féroce réaction capitaliste, et à une explosion dévastatrice d’impérialisme », c’est-à-dire à la guerre.[3]
Au lendemain de celle-ci, l’hégémonie américaine et son rôle de gendarme du monde capitaliste ne pouvaient plus être contestés par les bourgeoisies européennes ou japonaise. Comme l’avait exprimé déjà vingt ans plus tôt Trotsky dans Europe et Amérique : « Le capital américain commande maintenant aux diplomates. Il se prépare à commander également aux banques et aux trusts européens, à toute la bourgeoisie européenne. C’est ce à quoi il tend. Il assignera aux financiers et aux industriels européens des secteurs déterminés du marché. Il réglera leur activité. En un mot, il veut réduire l’Europe capitaliste à la portion congrue. »
Mais pour parer l’effondrement des États et toute menace révolutionnaire, l’essentiel des dettes des belligérants, dont celles de la France et de l’Allemagne, furent progressivement effacées par les États-Unis.
Durant les trois décennies suivantes, l’économie capitaliste reprit sa marche folle. Dans cette période, le prêt aux pays qu’on n’appelait pas encore émergents fut une activité très lucrative pour les capitaux qui y étaient placés. La pression de l’impérialisme, si elle avait changé de leviers, s’exerçait aussi violemment que dans la période coloniale. Les pays lourdement endettés saignèrent leur population pour rembourser leurs dettes et, le plus souvent, les seuls intérêts. Sous couvert d’allègement de ce fardeau, les plans imposés par le Fonds monétaire international aux États placés sous la menace de leurs créanciers les mirent à genoux. En outre, même lorsque était accordée l’annulation des dettes de certains pays, bien incapables de toute façon de faire face à leurs échéances de remboursement, les contreparties permettaient aux États impérialistes ou à leurs banques de mettre la main plus étroitement encore sur leur économie et leur politique, drainant ainsi toujours plus de richesses.
Un demi-siècle de crises et de chaos financier
En finançant par le déficit et la dette sa guerre contre le Vietnam, l’impérialisme américain porta un coup fatal au système dit de Bretton Woods qu’il avait lui-même imposé en 1945 et qui reposait sur la fable d’un dollar « as good as gold » (aussi bon que l’or). En 1971, pour ne pas avoir à faire face aux demandes massives de conversion en or de leur monnaie, dont ils avaient inondé sans aucune limite la planète, les États-Unis décrétèrent la fin de cette convertibilité. Peu après, l’économie capitaliste connaissait une nouvelle crise majeure de surproduction.
Sans refaire ici le récit des multiples crises financières qui ont ébranlé le monde depuis cette décision, il faut retenir qu’elles n’ont cessé de s’enchaîner, chaque solution immédiate préparant la crise suivante. Aucune ne pouvait résoudre le problème fondamental de l’anarchie de l’économie capitaliste et de la thrombose de son système productif.
La plus menaçante pour le système financier fut, en 2008, celle des subprimes, lorsque les avoirs des banques et des financiers, fondés sur les prêts immobiliers et la valeur des biens dont ils finançaient l’achat, s’effondrèrent comme un château de cartes.
Les financiers, détenteurs sous une forme ou sous une autre de ces titres devenus « toxiques » ou « radioactifs », furent alors massivement renfloués par les États. La dépréciation de leur capital, produit de leurs activités spéculatives, fut compensée. Les particuliers, en revanche, qui avaient emprunté pour se loger, furent jetés en pâture aux tribunaux sous le régime des faillites et, bien souvent, se retrouvèrent tout bonnement dépossédés de leurs biens et mis à la rue.
Aux États-Unis, sans doute plus que dans aucun autre pays capitaliste développé, s’endetter demeure aujourd’hui une nécessité pour se loger, se nourrir, se payer une voiture, tant le niveau des salaires est insuffisant pour la grande masse des travailleurs. Quant à ceux qui se lancent dans des études, ils savent qu’ils devront travailler la moitié de leur vie environ pour rembourser leur dette. Ils sont en quelque sorte comme les péons d’Amérique latine, contraints de s’échiner pour rembourser les outils ou le logement vendus à prix d’or par les propriétaires terriens décrits dans le roman La Révolte des pendus de B. Traven.
Le grand capital américain n’a pas ces problèmes : il dispose d’une monnaie toujours au centre des réserves de change des banques et des échanges mondiaux et d’un État qui, pour le servir, peut sembler pouvoir s’endetter presque à l’infini (de plus de 35 000 milliards de dollars actuellement) sans jamais avoir véritablement à rembourser ses créanciers. Il suffit d’obtenir du Congrès qu’il augmente le plafond de la dette publique. Michael Hudson, un économiste américain, le résume ainsi : « Dans la mesure où ces reconnaissances de dettes du Trésor sont intégrées à la base monétaire mondiale, elles n’auront jamais à être remboursées ; elles seront reconduites à l’infini. Cet aspect de la situation est l’essence du statut de “passager clandestin” des États-Unis en matière financière, c’est une taxe imposée à toute la planète. »[4]
Et c’est ainsi que l’impérialisme américain continue d’aspirer les capitaux du monde entier qui y trouvent un placement garanti. Du moins jusqu’à l’explosion inéluctable de ce système démentiel.
L’avertissement des spéculateurs à Trump
Dans la première semaine d’avril, Trump s’est lancé dans une guerre aussi soudaine que violente sur le terrain des droits de douane. Il a effectué ensuite une volte-face tout aussi brusque le 9 avril, réservant ses foudres à la Chine, imposée à 125 %, puis, le lendemain, à 145 %. Simultanément, une pause de 90 jours était décrétée, tous les autres pays devant être taxés à 10 %. Et quelques jours plus tard, une pause similaire a réduit, pour 90 jours également, de 145 % à 30 % les droits prélevés par les États-Unis sur les marchandises chinoises, et de 125 % à 10 % ceux qui pèsent sur les produits américains en sens inverse.
Cette suspension, peut-être provisoire, de la politique du gros bâton douanier semble avoir été provoquée par la pression colossale de la dette publique. Et plus directement encore celle de Jamie Dimon, PDG de la banque JP Morgan, porte-parole autorisé du capitalisme financier américain. Les banques et les fonds de pension sont en effet aujourd’hui les principaux détenteurs des bons du Trésor américain. Le caractère erratique de la politique de Trump et ses attaques contre la Fed (le système de réserve fédéral des États-Unis) avaient entraîné une brusque envolée des taux d’intérêt à long terme sur les places financières. Pour la première fois depuis des décennies, de placement sûr, voire refuge, la dette américaine était apparemment sur le point de devenir un repoussoir, ce qui pouvait signifier une difficulté pour l’État à financer le paiement de ses créanciers à l’avenir. Or les fonds alloués au remboursement des seuls intérêts de ces dettes atteindront 952 milliards de dollars cette année, soit plus que le budget de l’armée. Jusque-là, c’est le taux élevé des obligations du Trésor qui attirait ces mêmes capitaux. Le danger pour l’économie était d’autant plus important que leur rendement sert de référence pour une infinité de titres, les prêts hypothécaires, le taux des cartes de crédit de la population. Ils sont donc une sorte de clé de voûte sans laquelle le système financier américain s’écroulerait. Le scénario catastrophe d’un reflux des capitaux jusque-là attirés par la dette américaine est considéré aujourd’hui comme « plus sérieux que la crise de 2008 » par les uns, comme l’ouverture d’une « guerre financière » par les autres. Déjà, en mars 2020, il avait fallu l’intervention massive de la Réserve fédérale pour empêcher les « investisseurs », qui cherchaient à trouver des liquidités, de revendre leurs bons du Trésor, et enrayer la panique. Cette fois c’est le dernier revirement de Trump qui semble avoir calmé les grands financiers.
L’Union européenne face à « l’Himalaya des dettes »
Les États de l’Union européenne (UE) ne bénéficient pas des mêmes protections, ni leur bourgeoisie des mêmes assurances. Mais l’explosion des dettes publiques est également une manne pour les financiers. Elle accélère en même temps la lutte à mort entre puissances, comme l’ont montré la « crise de la dette » grecque et ses effets domino sur plusieurs États entre 2010 et 2015. Le montant des taux d’intérêt auxquels empruntait un État y était alors inversement proportionnel à sa puissance économique : c’est ainsi que la Grèce avait été contrainte de lever des fonds à des taux prohibitifs qui avaient fait exploser sa dette, la rendant insolvable, tandis que l’Allemagne put même emprunter durant une période à des taux négatifs. Comme si chaque État de l’UE avait de facto conservé sa propre monnaie. Cette crise avait menacé la survie même de l’euro, qui réunit désormais la majeure partie des pays de l’UE.
En 2026, les 27 États de l’UE vont devoir lever près de 1 300 milliards d’euros pour combler une partie de leurs déficits et payer les intérêts de leurs dettes. Depuis une décennie, une large partie de celles-ci était acquise par la Banque centrale européenne (BCE), laquelle a possédé jusqu’à la moitié des dettes des États de la zone euro. Or celle-ci a cessé ces achats depuis le 1er janvier 2025. Les taux d’intérêt se sont mis à grimper en Europe, les banques et autres institutions financières exigeant désormais des taux plus rémunérateurs. Ces taux augmentent même malgré l’absence de risque quand il s’agit de prêter à des États solvables comme la France ou l’Allemagne.
Aujourd’hui, après les « pays du Sud », c’est désormais la France qui semble au centre des attentions. Il faut dire qu’elle devrait lever, via l’Agence France Trésor, environ 340 milliards d’euros en 2025, un quart des émissions de la zone euro. Il s’agit en vérité d’une rente de situation ancienne pour la bourgeoisie. En cumulant les intérêts payés depuis 1960, l’État français, lui, a déjà versé en effet près de 2 700 milliards d’euros… tandis que sa dette a augmenté de 3 000 milliards. Autrement dit, l’État a déjà pratiquement remboursé en intérêts tout ce qu’il a emprunté… mais il doit toujours s’acquitter de sa dette. Et tout bourgeois garde en mémoire le fameux « emprunt Giscard » de 1973, indexé sur l’or, qui permit aux rentiers de faire fructifier leur fortune : 6,5 milliards de francs furent récoltés mais, vingt-cinq ans plus tard, il en avait coûté 85 milliards à l’État (50 au titre du remboursement du capital et 35 au titre des intérêts).
Les intérêts de la dette, payés annuellement au grand capital, sont de l’ordre de 50 milliards d’euros ces dernières années, un montant proche du budget de l’Éducation, et ils vont continuer à grimper, exposant l’État à des assauts spéculatifs. Un quart de cette dette est d’ailleurs indexé à l’inflation. Et la France emprunte déjà actuellement à des taux plus élevés que l’Espagne, l’Italie, voire la Grèce. Le risque existe, pour une fraction de la bourgeoisie, de se voir ainsi privée de sommes qui lui revenaient jusque-là et qui s’ajoutaient à tous les dispositifs alimentant ses caisses. Mais c’est aussi une opportunité pour une autre fraction…
Les dettes et la marche à la guerre
Le bellicisme des principaux dirigeants européens, pris de vitesse par la volte-face de Trump vis-à-vis de l’Ukraine, qui dévoilait notamment les visées de l’impérialisme américain sur ses terres rares, relance aujourd’hui la question des déficits et de la dette.
Elle sert de prétexte depuis des décennies pour justifier des mesures d’austérité et toutes les attaques contre la classe ouvrière ou les services publics. Il faudrait à chacun payer ses dettes rubis sur l’ongle pour ne pas laisser « à ses enfants et à ses petits-enfants » cette charge insurmontable. Il va de soi pour les travailleurs conscients qu’ils ne sont pour rien dans des montagnes de dettes qui n’ont enrichi que les usuriers et les financiers, et qu’ils n’ont pas à les payer.
Mais désormais, c’est le réarmement de l’Europe qui est utilisé comme alibi pour desserrer quelque peu les cordons des finances publiques, quitte à oublier les célèbres « critères de Maastricht » invoqués depuis deux décennies. La pression monte simultanément sur les travailleurs, et les dépenses un tant soit peu utiles à la population sont rognées année après année.
Dans le cadre d’un plan à 800 milliards d’euros, l’UE vient d’autoriser les États à dépasser le plafond théorique acceptable de leur dette (fixé à 60 % de leur PIB), 150 milliards étant d’ores et déjà réservés pour des dépenses militaires. La France, dont la dette s’élève à 115 % de son PIB, a doublé son budget de la défense en cinq ans et prévoit de le porter à 100 milliards, son « poids de forme » souhaitable selon Lecornu, le ministre de la Défense. Des projets de plan d’épargne, adossé au livret A, alimentant la politique de réarmement ou le passage à une forme d’économie de guerre, ou de « grand emprunt » faisant appel au patriotisme, sont à l’étude. Comme si d’ailleurs les masses de capitaux déposées dans les banques, sur les comptes des mutuelles et sur les divers produits d’épargne, n’alimentaient pas déjà les industries de la défense et le réarmement !
En Allemagne, Merz, le nouveau chancelier CDU-CSU (droite), a passé un accord avec le SPD (social-démocrate) et les Verts, avant même sa nomination, pour un plan à 500 milliards, dont 400 pour le réarmement, qui s’ajoutent aux 100 milliards déjà budgétés par le gouvernement précédent. Le « frein à l’endettement », loi constitutionnelle adoptée en 2009 qui limitait jusqu’ici les possibilités de creuser le déficit budgétaire et donc les dettes, a été levé. « L’Allemagne revient de vacances au front », titrait la Frankfurter Allgemeine Zeitung quand d’autres journaux évoquaient « Une situation historique », « une orgie de dette », « un réarmement gigantesque et illimité ».
C’est la pédale de l’accélérateur qui est donc désormais utilisée. La bourgeoisie d’Europe sait de longue date qu’elle peut compter sur les partis de la social-démocratie. Avec les Verts, de plus en plus kakis, ou un Raphaël Glucksmann en France, elle dispose d’une agence de propagande en faveur du militarisme, qui pourra lui être utile auprès de la jeunesse et d’une certaine fraction de la population pour faire passer ses mesures d’austérité.
Tous les organismes dédiés à la surveillance de la dette globale constatent que la croissance vertigineuse de l’endettement constitue une « dynamique dangereuse ». Personne ne peut non plus prévoir les conséquences que l’arrêt brutal des activités de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid) pourrait avoir sur certains pays menacés de défaut de paiement, ou l’effet sur l’économie mondiale des à-coups et des annonces contradictoires de la politique d’un Trump.
Mais la véritable source de danger est de laisser l’économie dans les mains de la grande bourgeoisie, à commencer par les instruments de sa dictature financière. Se libérer de l’emprise de la dette, implique d’arracher le pouvoir à la bourgeoisie. Incapable de développer les forces productives et de satisfaire les besoins les plus élémentaires de l’humanité, celle-ci devient de plus en plus parasitaire. Dans le Programme de transition, et afin de réaliser « un système unique d’investissement et de crédit », Trotsky évoquait la nécessité d’exproprier les banques et de fusionner tout le système de crédit entre les mains de l’État et sous le contrôle des travailleurs. Il y voyait la seule façon pour les exploités de disposer d’un « état-major financier » à même d’organiser une véritable planification de l’économie. Cet objectif reste à l’ordre du jour des communistes révolutionnaires.
12 mai 2025