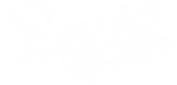Quatre mois après le retour de Trump à la tête de l’État américain, la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’est toujours pas terminée. La plupart des médias en France en parlent comme d’un échec du président américain. Comme si Trump, aveuglé par son désir de paix, avait été incapable de voir la duplicité de Poutine, contrairement aux européens Macron, Starmer et Merz qui, eux, entendraient soutenir « l’indépendance » de l’Ukraine « jusqu’au bout », quitte à prolonger la guerre.
Mais la réalité est tout autre : les alliés de l’Ukraine se sont servis d’elle pour mener une guerre contre la Russie par procuration, lui fournissant des armes mais laissant les Ukrainiens se sacrifier pour d’autres intérêts que les leurs. Car le véritable enjeu de cette guerre a été, dès le début, la mainmise sur une Ukraine en position stratégique aux portes de la Russie et sur ses nombreuses ressources naturelles. L’indépendance d’un pays comme l’Ukraine, dans le monde impérialiste, est une chimère. La question que posait cette guerre était de savoir quel partage du butin ukrainien entre les grandes puissances résulterait du rapport de force entre belligérants.
Trump, à la tête du principal pays de la coalition impérialiste a, dès son retour à la Maison Blanche, brutalement sonné la fin de la partie, en accordant la quasi-reconnaissance des territoires conquis par l’armée russe et en tordant le bras à Zelensky pour obtenir de l’Ukraine des avantages pour les capitalistes américains, au détriment de leurs concurrents européens. Le 8 mai, le Parlement ukrainien a ainsi ratifié l’accord imposé par les États-Unis pour exploiter et tirer profit des ressources naturelles du pays, des minerais, du gaz et du pétrole. Сet accord permettra aussi aux entreprises américaines de se positionner avantageusement sur le marché de la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, un chantier évalué à plusieurs milliards de dollars. S’estimant lésés, les dirigeants de l’Union européenne essayent encore, en adoptant la posture de meilleurs soutiens du gouvernement ukrainien, d’obtenir une part du gâteau.
Le rapprochement entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine a donc été présenté comme une surprise et même un choc. Et pourtant, il n’a rien d’étonnant : les dirigeants de la Russie, à la tête d’un État reçu en héritage de l’URSS, représentants d’une bureaucratie elle-même héritière de la bureaucratie soviétique, ont certes des intérêts qui les ont maintes fois opposés aux dirigeants de l’impérialisme, mais toute leur histoire montre qu’ils ont su souvent s’entendre aussi avec ces derniers aux dépens des peuples et des travailleurs qu’ils exploitent et qu’ils pillent, complices pour les maintenir dans l’oppression et la soumission.
Et en réalité, cette complicité essentielle entre la bureaucratie et l’impérialisme remonte au temps où l’URSS existait encore, et date de l’origine même de l’établissement du pouvoir de la bureaucratie à l’époque de Staline.
Fondamentalement, dans l’État de la révolution ouvrière d’Octobre 1917, dès le moment où le pouvoir passa des mains des classes laborieuses à celles d’une bureaucratie parasitaire, réactionnaire et violemment opposée à tout nouveau changement révolutionnaire de l’ordre mondial, le régime de la bureaucratie stalinienne ne pouvait que chercher à s’entendre avec les gardiens traditionnels du système capitaliste. Et que ces derniers aient bien souvent refusé leurs offres de services, préférant chercher d’abord à se débarrasser de ce corps étranger qu’était l’URSS, ne change rien à leur complicité essentielle pour empêcher qu’à nouveau des secousses révolutionnaires n’ébranlent le monde.
L’abandon de la perspective révolutionnaire par la bureaucratie stalinienne
De 1918 à 1921, pour endiguer la vague révolutionnaire qui suivit la révolution d’Octobre 1917 en Russie, les puissances impérialistes, dans une union sacrée pour sauver leur système, se liguèrent pour soutenir la contre-révolution. Pendant encore trois ans après la guerre impérialiste, les travailleurs soviétiques durent tout sacrifier pour vaincre armées blanches et corps expéditionnaires étrangers.
Au lendemain de la guerre civile, faute d’avoir pu renverser l’État ouvrier, les pays impérialistes se dirent prêts à avoir des relations économiques et politiques avec lui. Les révolutionnaires n’étaient pas dupes et Trotsky écrivait : « Que veut la diplomatie ? Imposer à la Russie révolutionnaire le plus lourd tribut possible ; l’obliger à payer le plus de réparations possibles ; élargir, autant que faire se peut, sur le territoire soviétique, le cadre de la propriété privée ; créer, pour les financiers, les industriels, les usuriers russes et étrangers, le plus grand nombre de privilèges aux dépens des ouvriers et des paysans russes. »[1]
Mais, reprise ou pas des relations avec l’Occident impérialiste, ce qui serait décisif pour le sort de l’État ouvrier, c’était que la révolution s’étende. Lénine répétait : « Sans l’aide en temps voulu de la révolution internationale nous ne tiendrons pas. » En attendant, l’objectif des révolutionnaires était de renforcer l’État ouvrier, en posant les bases d’une économie qui ne serait pleinement socialiste que plus tard, lorsque la révolution aurait gagné de nouveaux pays. L’URSS s’efforça ainsi d’obtenir des relations avec les pays capitalistes les moyens de relancer son économie encore arriérée et ruinée par sept années de guerre mondiale puis civile. Parallèlement, les révolutionnaires faisaient tout leur possible, à travers l’Internationale communiste, pour que la révolution l’emporte dans d’autres pays.
Mais la révolution mondiale marquant le pas, c’est au cours de ces mêmes années que la bureaucratisation de l’État ouvrier et du Parti communiste devint un phénomène envahissant, un danger mortel pour l’avenir de l’État soviétique. La bureaucratie, couche sociale formée de millions de responsables, des sommets à la base de l’État, se comportait comme une caste, aspirant de plus en plus consciemment à assurer sa position et ses privilèges contre tout ce qui pouvait les menacer, à commencer par la classe ouvrière.
Après la mort de Lénine, Staline incarna ce revirement politique et social. En affirmant en décembre 1924, que le socialisme était possible « dans un seul pays », le chef de la bureaucratie afficha à la face du monde, et donc de l’impérialisme, que le régime tournait le dos à la révolution mondiale. En même temps, la bureaucratie lançait une lutte implacable contre ceux qui, au sein du Parti communiste, restaient des révolutionnaires. L’URSS ne s’effondra pas, mais elle subit une défaite majeure de l’intérieur : le régime révolutionnaire avait dû céder le pouvoir à une formidable force opposée à tout changement social. C’était un phénomène inédit dans l’histoire.
Sur le plan des relations internationales, la rupture avec le passé bolchevique ne fut pas moindre. Désormais, la bureaucratie n’entendait plus aider d’aucune manière la classe ouvrière des autres pays à s’emparer du pouvoir. Elle craignait une nouvelle vague révolutionnaire qui, en réveillant la combativité des travailleurs en URSS, risquerait de remettre en cause son propre pouvoir. Dès lors, sous des formes variées mais avec une même orientation constante, la diplomatie soviétique chercha un terrain d’entente avec la bourgeoisie des pays impérialistes.
Des fronts populaires au pacte germano-soviétique : choisir un camp impérialiste contre l’autre
Pour être acceptés comme interlocuteurs et partenaires par l’impérialisme, les bureaucrates allaient devoir donner des gages, prouver que, sous la dictature de Staline, l’URSS ne représentait plus un danger révolutionnaire. Car l’impérialisme voyait l’existence même de l’URSS comme une menace. Même sous la férule de la bureaucratie et à son corps défendant, l’URSS représentait aux yeux des exploités du monde entier un espoir, la preuve que la classe ouvrière au pouvoir était capable de construire – à l’échelle d’un sixième des terres émergées ! – une société qui fonctionnait sans propriété privée des moyens de production et sans capitalistes.
Il fallut les échecs des révolutions de l’entre-deux-guerres, de plus en plus ouvertement provoqués par la bureaucratie, pour que l’impérialisme se convainque qu’il pouvait s’entendre avec Staline et qu’il pouvait avoir intérêt à compter avec son régime, quoi qu’il lui en coûte de le cautionner du même coup.
Ce fut d’abord la tragédie de la révolution chinoise, en 1925-1927, lors de laquelle l’Internationale communiste en voie de stalinisation poussa le jeune Parti communiste chinois à mener une politique suicidaire en se mettant à la remorque d’un parti bourgeois, le Kuomintang. Cette politique aboutit à l’écrasement de la classe ouvrière et au massacre des communistes chinois par les nationalistes, que Staline s’obstinait à leur présenter comme leurs meilleurs alliés.
Puis il y eut le coup de tonnerre de l’arrivée de Hitler au pouvoir en janvier 1933, une défaite sans combat des travailleurs et du Parti communiste allemands, paralysés par la politique utra-gauche suicidaire des dirigeants staliniens. Hitler au pouvoir, c’était la menace d’une nouvelle guerre contre l’URSS et, sur ce terrain, l’Allemagne pouvait obtenir l’approbation tacite sinon le soutien des autres pays impérialistes. C’est alors que Staline, pour faire face à la menace, proposa de s’allier à la bourgeoisie dite démocratique des impérialismes rivaux de l’Allemagne. C’était le fondement de sa politique des fronts populaires.
Au milieu des années 1930, les fronts populaires consistèrent en une alliance électorale des partis communistes avec la social-démocratie réformiste et des partis bourgeois, comme les radicaux en France. Remplaçant le langage de la lutte de classe par celui du patriotisme, les PC prirent un tournant nationaliste. En France, dans les manifestations, le drapeau tricolore et la Marseillaise apparurent aux côtés du drapeau rouge et de l’Internationale. Face à la nouvelle guerre impérialiste qui s’annonçait, l’Internationale communiste répandit le mythe d’une lutte des démocraties contre le fascisme et défendit une politique pacifiste, sans plus évoquer la perspective de la révolution.
Ce tournant rassura la bourgeoisie, et l’URSS put ainsi entrer dans le jeu des alliances entre puissances impérialistes. Staline la fit adhérer fin 1934 à cette SDN (ancêtre de l’ONU) que Lénine avait qualifiée de « caverne de brigands » impérialistes. La même année, Trotsky écrivait : « Le danger révolutionnaire que constitue le communisme a perdu de son acuité, en dépit de la terrible crise. Les succès diplomatiques de l’Union soviétique sont à attribuer, au moins dans une large mesure, à l’extrême affaiblissement de la révolution internationale. »[2]
Le caractère contre-révolutionnaire de la politique de front populaire se révéla pleinement lorsque la classe ouvrière manifesta de nouveau sa volonté de se battre. En France, le gouvernement de Blum, à peine élu avec le soutien du Parti communiste, ce dernier saborda la grève générale de juin 1936. Il empêcha que la mobilisation de millions de prolétaires se transforme en mouvement révolutionnaire.
Et en Espagne peu après, quand la révolution éclata en réaction au coup d’État de Franco, la guerre civile fut menée, côté républicain, derrière le gouvernement bourgeois de Front populaire. L’URSS envoya des armes à l’Espagne républicaine, et le Parti communiste d’Espagne, qui participait à ce gouvernement, se chargea de liquider les courants et milices révolutionnaires, anarchistes et communistes antistaliniens. Une fois brisée la mobilisation révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie, le Front populaire étant incapable de vaincre militairement le franquisme, l’allié de Hitler et de Mussolini n’allait plus rencontrer d’obstacle pour établir sa dictature.
La guerre impérialiste approchant, Staline constatait cependant avec effroi que les « démocraties » n’avaient aucune volonté de s’opposer vraiment à l’Allemagne nazie ni, a fortiori, de défendre l’URSS contre les visées militaires de Berlin. Alors, il engagea des négociations en coulisse avec les dirigeants nazis. Elles débouchèrent à la stupeur générale sur le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui laissait les mains libres à Hitler pour commencer la guerre à l’ouest. C’était un coup de poignard dans le dos des militants communistes auxquels Staline et les partis communistes expliquaient depuis des années que le fascisme était l’ennemi à abattre. Cela ne pouvait que démoraliser ceux qui voyaient dans l’URSS le meilleur rempart contre le fascisme. Le pacte prévoyait, entre autres, le partage de la Pologne entre les deux pays, ce qui allait marquer le début officiel de la guerre mondiale quelques jours plus tard. Pourtant, le répit qu’espérait Staline ne dura guère : il prit fin avec l’invasion allemande du 22 juin 1941.
Yalta : le maintien de l’ordre impérialiste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale
Au cours de la guerre, l’URSS réussit à repousser l’invasion allemande puis à faire avancer une armée de six millions d’hommes sur un front de 5 000 km. L’armée du Kremlin ayant pris Berlin, elle occupa finalement une large partie de l’Europe.
Cela ouvrit une période nouvelle des relations entre l’impérialisme et l’URSS de Staline : celle d’une complicité non seulement de fait, mais décidée, ouverte et élaborée en commun. En gage de sa bonne volonté, en 1943, Staline liquida l’Internationale communiste, déjà depuis longtemps réduite à l’impuissance, et il débaptisa l’Armée rouge pour en supprimer l’adjectif « rouge » qui rappelait sa lointaine origine révolutionnaire.
Entre 1943 et 1945, plusieurs rencontres au sommet réunirent Staline et les représentants impérialistes anglo-américains, Roosevelt et Churchill, qui s’allièrent à lui contre l’Allemagne de Hitler et ses alliés. Mais il ne s’agissait pas seulement de vaincre les puissances de l’Axe. La principale préoccupation des impérialistes concernait l’après-guerre. Ils craignaient que la guerre mondiale se termine, comme la précédente, par une vague révolutionnaire ébranlant le système capitaliste tout entier. Ils savaient donc d’expérience que la défaite de l’Allemagne et de l’Italie serait marquée par des crises dans ces pays et en Europe, des convulsions, des affrontements sociaux et politiques. Pour prévenir ce danger, la meilleure garantie était une alliance avec l’URSS de Staline, qui accepta de jouer le rôle qu’on attendait de lui pour, enfin, être admis à la table des grands de ce monde. Ses troupes et ses tanks firent régner l’ordre en Europe de l’Est, et, partout, il dicta la politique des partis communistes, dont l’influence dans la classe ouvrière pouvait être décisive pour briser de l’intérieur une montée ouvrière.
Lors des conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam, les alliés se partagèrent les zones d’influence où leurs armées respectives feraient régner l’ordre, l’URSS étant reconnue comme puissance dominante sur l’est de l’Europe. Churchill a raconté dans ses mémoires comment, avec Staline, il régla en deux minutes le sort de plusieurs pays des Balkans, attribuant 90 % du contrôle de la Roumanie à l’URSS, 90 % de celui de la Grèce à la Grande-Bretagne, et se partageant en parts égales l’influence sur la Yougoslavie et la Hongrie.
L’armée soviétique, dans les territoires qu’elle occupait, se comporta comme les armées impérialistes ailleurs. Il fallait faire en sorte que pas un ouvrier, en Allemagne ou en Europe de l’Est, ne puisse voir en elle une armée de libération, tuer tout espoir qu’elle aurait pu susciter malgré elle.
Après la guerre, certains partis communistes eurent même leurs ministres dans des gouvernements bourgeois, notamment en Italie et en France. Et quand il y eut des grèves et des mobilisations populaires, les partis communistes mirent tout leur poids pour qu’elles ne débouchent pas sur une crise révolutionnaire. En Grèce, passée sous autorité britannique, le Parti communiste fut massacré, sans même que Staline réagisse. Enfin, au moment où les États-Unis lâchèrent deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, l’URSS déclara la guerre au Japon, occupant la Mandchourie pour y maintenir l’ordre.
L’équilibre de la guerre froide
Une fois l’Europe capitaliste remise sur les rails et tout danger révolutionnaire immédiat écarté, l’impérialisme préférait ne plus devoir passer par des accords avec l’URSS. Par nature, il restait fondamentalement hostile à l’État issu de la révolution d’Octobre, d’autant plus gêné par son prestige et le statut de grande puissance avec lesquels il était sorti de la guerre.
C’est pourquoi à la collaboration ouverte se substitua bientôt la « guerre froide ». Pour attirer de son côté les pays européens et y réduire l’influence soviétique, l’impérialisme américain lança le plan Marshall. Pour protéger la zone qu’elle occupait, l’URSS y installa des gouvernements à sa botte, constituant un glacis qui allait former avec elle le « bloc soviétique », coupé du bloc occidental à partir de 1947-1948. Cet équilibre relatif entre les deux blocs allait durer une quarantaine d’années, jusqu’à la chute de l’URSS. Le retour de l’hostilité entre l’ensemble de l’impérialisme occidentalet l’Union soviétique prit par moments des allures menaçantes, faisant craindre une troisième guerre mondiale. En Corée notamment, la guerre sévit entre 1950 et 1953 et aboutit à la partition du pays en deux, s’ajoutant à l’épreuve de force qui se déroulait en Europe. Partout, les lignes de partage se figeaient.
Mais une complicité fondamentale entre les grandes puissances demeurait dirigée contre les peuples. Et cela quand bien même la bureaucratie russe, aussi viscéralement conservatrice et anti-ouvrière qu’elle ait été, continuait de maintenir certains acquis de la révolution d’Octobre, à commencer par l’étatisation des moyens de production et d’échange, la planification et le monopole du commerce extérieur. Elle allait agir de la sorte durant des décennies – en fait jusqu’en 1991 – non pas par une quelconque révérence pour Octobre 1917, mais parce que ce legs de l’histoire faisait sa puissance, et surtout constituait la base même de ses privilèges, en lui permettant de piller collectivement l’économie soviétique.
Lorsque, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, le prolétariat engagea la lutte en Europe de l’Est, c’est le Kremlin qui se chargea de la répression. En 1953 à Berlin-Est, puis en 1956 en Pologne et surtout en Hongrie, où une révolution éclata et où des conseils ouvriers réapparurent, l’URSS écrasa les insurgés. Le partage des rôles entre brigands pour maintenir l’ordre mondial se prolongeait ainsi malgré la guerre froide. Chacun allait accomplir ses propres crimes dans sa zone d’influence : les impérialistes contre les peuples du tiers-monde et les dirigeants soviétiques contre ceux de Tchécoslovaquie, de Pologne et d’Afghanistan.
Les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale virent encore une vague de révoltes indépendantistes se répandre dans les colonies, menaçant la domination impérialiste en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et soulevant des millions d’exploités. L’influence de la bureaucratie russe contribua à l’empêcher de prendre un caractère révolutionnaire et de déborder des cadres nationaux. Les partis communistes staliniens, devenus en fait des partis nationalistes, mirent le prolétariat à la remorque des partis indépendantistes bourgeois.
La bureaucratie soutint des régimes qualifiés de progressistes car ils refusaient de s’aligner systématiquement sur les États-Unis. Mais ces luttes de libération nationale visant à l’installation de bourgeoisies autochtones au pouvoir ne menaçaient en rien la domination impérialiste. Au bout du compte, celle-ci a perduré plusieurs décennies après la Deuxième Guerre mondiale sans être réellement menacée, grâce à la complicité de la bureaucratie russe.
De la chute de l’URSS au règne de Poutine, une même politique en héritage
À la fin des années 1980, le « bloc soviétique » se fissura et les pays d’Europe de l’Est rejoignirent l’un après l’autre le giron capitaliste, sans que l’URSS de Gorbatchev tente de s’y opposer. En 1991, ce fut l’URSS elle-même qui finit par imploser, en proie à des contradictions internes devenues insurmontables. La gabegie et le pillage croissant de la bureaucratie, ses incessantes luttes de clan, dans un contexte de stagnation économique, finirent par déstabiliser le pouvoir dans tout le pays, jusqu’au sommet de l’État. Les plus hauts bureaucrates eux-mêmes signèrent la fin de l’Union et son éclatement en quinze États dont la Russie allait rester le plus important.
Cette dissolution entraîna un recul considérable : la multiplication des frontières entre des peuples qui avaient vécu soixante-dix ans dans le cadre d’un même État, ce qui s’accompagna de guerres territoriales. La guerre en Ukraine, depuis 2014, en est une lointaine conséquence. L’économie des ex-républiques soviétiques connut un effondrement tel qu’on n’en voit généralement qu’en cas de guerre, y compris en Russie sous la présidence d’Eltsine, dans les années 1990. C’est aussi au cours de cette décennie de chaos et d’effondrement social que quelques oligarques, issus de la bureaucratie ou liés à elle, bâtirent des fortunes en s’appropriant des pans entiers de l’économie soviétique.
En Russie comme ailleurs en ex-URSS, hormis quelques oligarques et leurs clans, la majeure partie de la bureaucratie craignait d’y perdre de sa position sociale et de ses privilèges en même temps que son pouvoir. C’est en s’appuyant sur le mécontentement de cette bureaucratie qui refusait de se laisser dépouiller par les oligarques locaux et les financiers du monde entier que Poutine accéda au pouvoir en 2000. Il avait le soutien des représentants du KGB, de l’armée, des administrations et des organismes économiques issus de l’URSS.
Poutine rétablit ce qu’il appela la « verticale du pouvoir », imposant l’autorité du pouvoir central à des bureaucrates locaux qui se comportaient comme des seigneurs dans leur fief, et contraignant les oligarques à se soumettre au pouvoir politique et à partager la source de leur enrichissement avec les hautes sphères de la bureaucratie.
Une fois ce compromis passé entre le pouvoir politique de la bureaucratie et la nouvelle bourgeoisie des oligarques, le régime manifesta à plusieurs reprises sa volonté d’être intégré dans le système impérialiste, demandant à intégrer le FMI, l’Union européenne et même… l’OTAN, cette alliance militaire pourtant créée autour des États-Unis pour combattre l’URSS. Moscou offrit même des bases en Asie centrale pour les avions américains allant bombarder l’Afghanistan. En vain, l’impérialisme ne lui en sut aucun gré : il avançait ses pions toujours plus loin en Europe de l’Est, jusqu’à l’Ukraine. Cette pression croissante accula la Russie à réagir militairement, déjà en Ukraine en 2014. Si Poutine prit l’initiative de l’envahir en février 2022, c’est la politique de l’impérialisme, américain en tête, qui avait rendu cette guerre en quelque sorte inévitable.
Tout en défendant ses intérêts propres, utilisant ce qui reste de formidables moyens hérités de l’économie soviétique étatisée, la bureaucratie russe aspire encore et toujours à être reconnue comme une puissance à part entière collaborant au maintien de l’ordre bourgeois. Elle démontre, chaque fois qu’elle le peut, qu’elle sait se rendre utile au maintien du système capitaliste. Il suffit de rappeler comment un mois à peine avant l’invasion de l’Ukraine, en janvier 2022, Poutine avait envoyé des troupes au secours du dictateur du Kazakhstan que menaçait une révolte dont la classe ouvrière était l’élément moteur. Par la même occasion, il avait exaucé les vœux des nombreux trusts occidentaux présents dans ce pays.
Sur la forme, Trump étale son cynisme en tendant la main à Poutine et en accusant Zelensky d’être responsable de la poursuite de la guerre en Ukraine. Mais sur le fond il renoue avec cette complicité qui, à travers de nombreux épisodes, a vu les gouvernements impérialistes collaborer avec Staline et ses successeurs pour maintenir l’ordre bourgeois.
Cette politique s’inscrira-t-elle dans la durée ? Aura-t-elle pour effet d’amorcer un processus de réintégration du régime russe dans le système capitaliste et son ordre mondial ? L’avenir le dira, mais derrière les tristes pantomimes de Trump et les flots de sang répandus en Ukraine, c’est une perspective qui s’ouvre peut-être et pour la bourgeoisie, et pour la bureaucratie. Qu’elle risque de se concrétiser souligne a contrario combien le système capitaliste a perdu de son dynamisme originel, lui, auquel il aura fallu un siècle pour réintégrer une bureaucratie qui ne demandait finalement que cela.
15 mai 2025